Qu’a laissé la visite du pape François en Grèce et à Chypre, près d’un mois plus tard ? Nous avons interrogé la communauté des Focolari des deux pays. Un mois après le voyage de François en Grèce et à Chypre, ce quadrant du globe continue d’être sous le feu des projecteurs internationaux. Ces derniers jours, nous avons lu l’histoire d’espoir de Grace Enjei, une Camerounaise de 24 ans qui, grâce à la visite du pape et à l’aide de la Communauté de Sant’Egidio, est arrivée à Rome depuis le « no man’s land » de Chypre avec 10 autres demandeurs d’asile. Mais nous avons également appris l’énième naufrage en mer Égée, celui qui s’est produit le jour de Noël, dans lequel 13 migrants ont perdu la vie. Grèce et Chypre. Deux pays avec une population relativement faible (les catholiques sont une minorité religieuse) mais qui sont le miroir des principales crises mondiales : des forts courants migratoires, à la crise financière et sanitaire. Ils souffrent en particulier des influences politiques inquiétantes de leurs voisins turcs. Nous avons demandé à la communauté des Focolari de ces pays ce que ce voyage apostolique leur a laissé, quels sont les pas à accomplir vers la paix et une coexistence plus humaine pour tous. 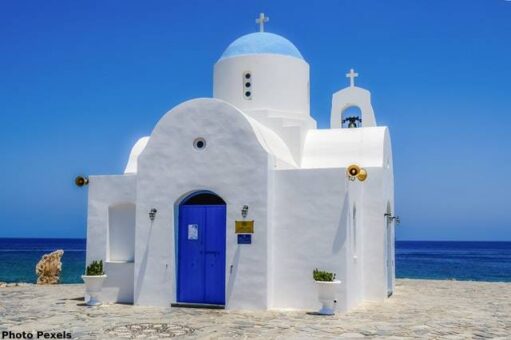 Lina Mikellidou, orthodoxe et responsable de la communauté des Focolari à Chypre, n’a aucun doute : « Lorsque le pape François a déclaré que nous devions faire de cette île ‘’ un laboratoire de la fraternité’’, il a mis le doigt sur le problème. Chypre est occupée par les Turcs depuis 1974 et la capitale Nicosie est la dernière ville européenne à être divisée par des barbelés. Les tentatives de recomposition de ces fractures n’ont pas abouti à des résultats concrets malgré les efforts de la communauté internationale et des deux parties ces dernières années. Je pense qu’il est nécessaire de développer ou de renforcer les plateformes, les lieux de dialogue entre les différentes réalités qui existent à Chypre, c’est-à-dire entre les chrétiens de différentes confessions (comme les Arméniens, les Latins, les Maronites et les Orthodoxes) et aussi avec les Musulmans. Il est ensuite nécessaire de cultiver l’esprit d’ ‘’unité dans la diversité’’ entre les deux Églises sœurs, catholique et orthodoxe. Et enfin, il y a le chapitre des migrants. Leur nombre n’est pas supportable pour notre pays, tant sur le plan logistique qu’économique. Mon peuple est connu pour sa générosité et son esprit d’accueil : beaucoup a déjà été fait pour les réfugiés, mais nous pouvons certainement nous améliorer, en essayant de sensibiliser, de trouver des fonds et des structures pour que ces frères à nous vivent dans des conditions plus humaines et plus dignes ». « Le pape nous a encouragés à avoir un nouveau regard – conclut Lina – une vive attention aux questions brûlantes telles que les migrants et le dialogue œcuménique. La recherche d’unité entre le pape François et le patriarche œcuménique de Constantinople, S. B. Bartholomée, nous donne une grande espérance : une relation fraternelle, faite de gestes concrets et d’un dialogue profond ». Alexandros Oshana, un jeune d’Athènes issu de la communauté locale des Focolari, soutient que le chemin vers le dialogue œcuménique est encore long : « En ce sens – dit-il – la visite du pape a offert la possibilité d’un nouveau départ. Dans ses discours, il utilisait souvent les mots ‘’unité’’, ‘’fraternité’’, ‘’dialogue’’. Le pape a appelé à une Église inclusive, ouverte à ceux qui souffrent. François nous a tous exprimé, nous Grecs catholiques, à 100%, notre intention d’être proches de nos frères et sœurs orthodoxes et de nous sentir avant tout ‘’chrétiens’’. À cet égard, le propre exemple que le pape François a voulu donner n’a échappé à personne. Afin de souligner que l’unité n’est possible que par un acte complet d’humilité, il a lui-même demandé à nouveau pardon à l’archevêque orthodoxe Ieronimos pour les erreurs commises dans le passé par les catholiques envers les orthodoxes. L’archevêque lui-même a déclaré qu’il était sûr qu’il serait possible de « se débarrasser des fardeaux du passé, en particulier ceux liés aux événements de la guerre d’indépendance grecque ». En signe de fraternité, il a également déclaré vouloir rejoindre François ‘’dans l’énorme défi’’ concernant le sort des migrants et entreprendre ‘’une action commune pour l’environnement’’.
Lina Mikellidou, orthodoxe et responsable de la communauté des Focolari à Chypre, n’a aucun doute : « Lorsque le pape François a déclaré que nous devions faire de cette île ‘’ un laboratoire de la fraternité’’, il a mis le doigt sur le problème. Chypre est occupée par les Turcs depuis 1974 et la capitale Nicosie est la dernière ville européenne à être divisée par des barbelés. Les tentatives de recomposition de ces fractures n’ont pas abouti à des résultats concrets malgré les efforts de la communauté internationale et des deux parties ces dernières années. Je pense qu’il est nécessaire de développer ou de renforcer les plateformes, les lieux de dialogue entre les différentes réalités qui existent à Chypre, c’est-à-dire entre les chrétiens de différentes confessions (comme les Arméniens, les Latins, les Maronites et les Orthodoxes) et aussi avec les Musulmans. Il est ensuite nécessaire de cultiver l’esprit d’ ‘’unité dans la diversité’’ entre les deux Églises sœurs, catholique et orthodoxe. Et enfin, il y a le chapitre des migrants. Leur nombre n’est pas supportable pour notre pays, tant sur le plan logistique qu’économique. Mon peuple est connu pour sa générosité et son esprit d’accueil : beaucoup a déjà été fait pour les réfugiés, mais nous pouvons certainement nous améliorer, en essayant de sensibiliser, de trouver des fonds et des structures pour que ces frères à nous vivent dans des conditions plus humaines et plus dignes ». « Le pape nous a encouragés à avoir un nouveau regard – conclut Lina – une vive attention aux questions brûlantes telles que les migrants et le dialogue œcuménique. La recherche d’unité entre le pape François et le patriarche œcuménique de Constantinople, S. B. Bartholomée, nous donne une grande espérance : une relation fraternelle, faite de gestes concrets et d’un dialogue profond ». Alexandros Oshana, un jeune d’Athènes issu de la communauté locale des Focolari, soutient que le chemin vers le dialogue œcuménique est encore long : « En ce sens – dit-il – la visite du pape a offert la possibilité d’un nouveau départ. Dans ses discours, il utilisait souvent les mots ‘’unité’’, ‘’fraternité’’, ‘’dialogue’’. Le pape a appelé à une Église inclusive, ouverte à ceux qui souffrent. François nous a tous exprimé, nous Grecs catholiques, à 100%, notre intention d’être proches de nos frères et sœurs orthodoxes et de nous sentir avant tout ‘’chrétiens’’. À cet égard, le propre exemple que le pape François a voulu donner n’a échappé à personne. Afin de souligner que l’unité n’est possible que par un acte complet d’humilité, il a lui-même demandé à nouveau pardon à l’archevêque orthodoxe Ieronimos pour les erreurs commises dans le passé par les catholiques envers les orthodoxes. L’archevêque lui-même a déclaré qu’il était sûr qu’il serait possible de « se débarrasser des fardeaux du passé, en particulier ceux liés aux événements de la guerre d’indépendance grecque ». En signe de fraternité, il a également déclaré vouloir rejoindre François ‘’dans l’énorme défi’’ concernant le sort des migrants et entreprendre ‘’une action commune pour l’environnement’’.
Lorenzo Russo avec la collaboration de la communauté des Focolari de Grèce et de Chypre




0 commentaires