 La ville d’Atlanta, en Géorgie, est la neuvième grande métropole des USA, le siège de Coca Cola et aussi la ville natale de Martin Luther King. I have a dream, j’ai un rêve, s’écriait en 1963 le leader de la non-violence, en réclamant l’égalité entre blancs et noirs, et en espérant qu’un jour se réaliserait le credo de la nation américaine, à savoir « que tous les hommes ont été créés égaux », comme on peut le lire dans la Déclaration d’Indépendance de 1776. Depuis il y a eu de nombreuses avancées, au moins formellement. C’est aussi le témoignage de Celi Montero, Costaricaine, « blanche », qui a vécu pendant 20 ans à Los Angeles, et au cours des dernières années à Atlanta, où elle a travaillé comme assistante dans un institut technique. « J’entendais dire qu’il y avait encore des épisodes de discrimination, mais cela me semblait des histoires exagérées. Je pensais qu’il n’en était pas vraiment ainsi. Mais hélas, j’ai dû me raviser ». C’est une histoire récente : en 2015, précisément à Atlanta, le meurtre d’un jeune afro-américain sans armes, de nouvelles violences à Baltimore, à Ferguson, l’essor du mouvement Black lives matter qui dénonce la pauvreté et le malaise des communautés noires et la violence de la police. Plus récemment en Louisiane et dans le Minnesota… dans une des nombreuses manifestations la haine tue cinq policiers et en blesse sept autres à Dallas. La tension se fait sentir est aussi à Atlanta où la population afro-américaine dépasse les 50%. Dans cette ville la communauté des focolari, qui reflète la démographie, s’engage à tisser des réseaux de réconciliation et à reconstruire le tissu social de l’intérieur. « Nos amis afro-américains ont peur de sortir de chez eux – raconte Celi – ils nous disent qu’ils craignent pour leur vie. Lorsque les conflits étaient plus fréquents, une amie avait peur d’aller faire ses courses. « Mais comme je crois au monde uni, je me suis reprise et suis sortie pour aimer tous ceux que je rencontrerais – me dit-elle -. Au supermarché je trouve une femme blanche qui présente un produit et elle s’arrête pour écouter. La femme comprend son geste et elles s’embrassent». C’est une situation latente qui souvent est amplifiée par le tamtam des réseaux sociaux. Après des années d’une lente progression, avec le « Civil Rights Movement » des années 60, dans le sud on rencontre encore l’inégalité sociale et économique. « Quelques-uns de mes jeunes amis afro-américains se sentent désavantagés par rapport aux jeunes blancs, quand il s’agit d’entrer à l’Université ou de trouver un emploi. « Arrivée en Géorgie je cherche du travail avec une amie noire – poursuit Celi -. Nous allons dans une agence pour l’emploi, elle est plus qualifiée que moi pour ce travail spécifique. Mais à moi ils me disent qu’ils m’appelleront prochainement, à elle on lui dit de retourner étudier et de mieux se préparer. La discrimination raciale était évidente. J’éprouve un profond dégoût : j’ouvre les yeux sur ce que de nombreuses personnes subissent chaque jour. Je fais mienne cette douleur et pour ma part, je cherche à tout faire pour construire des ponts au-delà des tensions que nous vivons ». « Avec de nombreux amis afro-américains musulmans nous réalisons ensemble de petites actions qui mobilisent toujours plus de monde. Nous préparons à manger et procurons des couvertures aux sans-abris de la ville, ou bien des sacs lorsque la police les oblige à se déplacer. Certains ont lancé des actions dans la paroisse d’un quartier riche pour subvenir aux besoins de 300 personnes. Ce sont de petites choses, mais elles témoignent d’un amour concret, au point que les musulmans disent : jusqu’ici nous dialoguions, maintenant nous sommes frères. Entre nous la question raciale est dépassée. Le jour où il y a eu des coups de feu, nous nous sommes retrouvés pour la rencontre de la Parole de Vie : nous avons partagé nos peurs, les incompréhensions et nous nous sommes dit les uns aux autres “Je suis ici pour toi” ! » « J’ai dans le cœur beaucoup d’espérance – conclut Celi – c’est vrai que nous sommes peu nombreux au milieu de ces problèmes : les conflits raciaux en sont un, mais ce n’est pas le seul. Il m’arrive de demander l’aide de Dieu pour entrer plus à fond dans cette culture afin de donner ensemble notre contribution spécifique : celle de l’unité là où il y a de nombreuses divisions ».
La ville d’Atlanta, en Géorgie, est la neuvième grande métropole des USA, le siège de Coca Cola et aussi la ville natale de Martin Luther King. I have a dream, j’ai un rêve, s’écriait en 1963 le leader de la non-violence, en réclamant l’égalité entre blancs et noirs, et en espérant qu’un jour se réaliserait le credo de la nation américaine, à savoir « que tous les hommes ont été créés égaux », comme on peut le lire dans la Déclaration d’Indépendance de 1776. Depuis il y a eu de nombreuses avancées, au moins formellement. C’est aussi le témoignage de Celi Montero, Costaricaine, « blanche », qui a vécu pendant 20 ans à Los Angeles, et au cours des dernières années à Atlanta, où elle a travaillé comme assistante dans un institut technique. « J’entendais dire qu’il y avait encore des épisodes de discrimination, mais cela me semblait des histoires exagérées. Je pensais qu’il n’en était pas vraiment ainsi. Mais hélas, j’ai dû me raviser ». C’est une histoire récente : en 2015, précisément à Atlanta, le meurtre d’un jeune afro-américain sans armes, de nouvelles violences à Baltimore, à Ferguson, l’essor du mouvement Black lives matter qui dénonce la pauvreté et le malaise des communautés noires et la violence de la police. Plus récemment en Louisiane et dans le Minnesota… dans une des nombreuses manifestations la haine tue cinq policiers et en blesse sept autres à Dallas. La tension se fait sentir est aussi à Atlanta où la population afro-américaine dépasse les 50%. Dans cette ville la communauté des focolari, qui reflète la démographie, s’engage à tisser des réseaux de réconciliation et à reconstruire le tissu social de l’intérieur. « Nos amis afro-américains ont peur de sortir de chez eux – raconte Celi – ils nous disent qu’ils craignent pour leur vie. Lorsque les conflits étaient plus fréquents, une amie avait peur d’aller faire ses courses. « Mais comme je crois au monde uni, je me suis reprise et suis sortie pour aimer tous ceux que je rencontrerais – me dit-elle -. Au supermarché je trouve une femme blanche qui présente un produit et elle s’arrête pour écouter. La femme comprend son geste et elles s’embrassent». C’est une situation latente qui souvent est amplifiée par le tamtam des réseaux sociaux. Après des années d’une lente progression, avec le « Civil Rights Movement » des années 60, dans le sud on rencontre encore l’inégalité sociale et économique. « Quelques-uns de mes jeunes amis afro-américains se sentent désavantagés par rapport aux jeunes blancs, quand il s’agit d’entrer à l’Université ou de trouver un emploi. « Arrivée en Géorgie je cherche du travail avec une amie noire – poursuit Celi -. Nous allons dans une agence pour l’emploi, elle est plus qualifiée que moi pour ce travail spécifique. Mais à moi ils me disent qu’ils m’appelleront prochainement, à elle on lui dit de retourner étudier et de mieux se préparer. La discrimination raciale était évidente. J’éprouve un profond dégoût : j’ouvre les yeux sur ce que de nombreuses personnes subissent chaque jour. Je fais mienne cette douleur et pour ma part, je cherche à tout faire pour construire des ponts au-delà des tensions que nous vivons ». « Avec de nombreux amis afro-américains musulmans nous réalisons ensemble de petites actions qui mobilisent toujours plus de monde. Nous préparons à manger et procurons des couvertures aux sans-abris de la ville, ou bien des sacs lorsque la police les oblige à se déplacer. Certains ont lancé des actions dans la paroisse d’un quartier riche pour subvenir aux besoins de 300 personnes. Ce sont de petites choses, mais elles témoignent d’un amour concret, au point que les musulmans disent : jusqu’ici nous dialoguions, maintenant nous sommes frères. Entre nous la question raciale est dépassée. Le jour où il y a eu des coups de feu, nous nous sommes retrouvés pour la rencontre de la Parole de Vie : nous avons partagé nos peurs, les incompréhensions et nous nous sommes dit les uns aux autres “Je suis ici pour toi” ! » « J’ai dans le cœur beaucoup d’espérance – conclut Celi – c’est vrai que nous sommes peu nombreux au milieu de ces problèmes : les conflits raciaux en sont un, mais ce n’est pas le seul. Il m’arrive de demander l’aide de Dieu pour entrer plus à fond dans cette culture afin de donner ensemble notre contribution spécifique : celle de l’unité là où il y a de nombreuses divisions ».
Allons vers ceux qui sont seuls
Allons vers ceux qui sont seuls



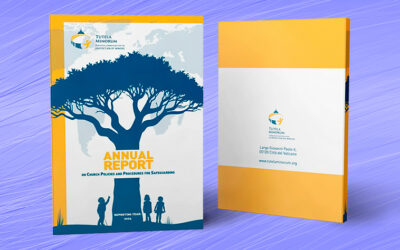
0 commentaires