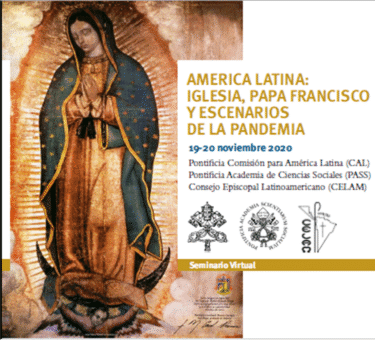Nov 24, 2020 | Non classifié(e)
A l’occasion du 50ème anniversaire de Religions pour la Paix, nous faisons le point sur les progrès réalisés et les perspectives d’avenir avec Azza Karram, élue Secrétaire Générale.  Azza Karram a été élue secrétaire générale de Religions pour la Paix en août 2019. Égyptienne d’origine, de nationalité néerlandaise, professeure d’études religieuses et de diplomatie, ancienne fonctionnaire des Nations unies, âme à dimension universelle, elle est aujourd’hui à la tête d’un mouvement auquel adhèrent plus de 900 responsables religieux de 90 pays, engagés avec elle pour faire de la paix un lieu de rencontre et un chemin à suivre en communauté. Religions pour la Paix a ouvert sa première assemblée du 16 au 21 août 1970. Elle était alors dirigée par Nikkyo Niwano, un esprit de grande vision, japonais et fondateur de la Rissho Kosei-kai. Dans les années 1990, il a invité Chiara Lubich à cette assemblée mondiale : il a trouvé en elle une consonance spirituelle et pragmatique unique. Cette année, Religions pour la Paix célèbre son 50ème anniversaire. Nous avons rejoint Azza Karram à New York pour lui demander une analyse du chemin effectué et les perspectives d’avenir. 50 ans après la fondation de Religions pour la Paix, quelle mission et quel message le mouvement continue-t-il à donner ? Notre témoignage après 50 ans de vie est qu’il est inévitable que les religions travaillent ensemble au-delà des différences institutionnelles, géographiques ou doctrinales. C’est le message que nous donnons, même si nous ne le réalisons pas encore parfaitement car nous savons qu’il y a un processus d’apprentissage constant et qu’il y a aussi la fatigue de travailler ensemble. Ensuite, le Covid a mis encore plus en évidence la nécessité d’un travail commun. Les communautés religieuses ou les ONG inspirées par des valeurs religieuses le font parce qu’elles ont été les premières à répondre à cette crise humanitaire, et non d’autres. Il est vrai que les institutions de santé sont également intervenues, mais elles n’auraient pas pu le faire de manière aussi capillaire sans les institutions religieuses qui ont non seulement apporté une réponse sanitaire, financière et psychologique à cette crise, mais qui ont su se pencher sur les besoins spirituels d’une communauté et y répondent à 100% sur tous les fronts. Cependant, combien de ces institutions religieuses, tout en répondant aux besoins d’une même communauté, travaillent ensemble ? Très peu et non par manque de besoins, d’efficacité ou de connaissances. Je soupçonne parfois que nous essayons en fait de sauver nos institutions et que collaborer en cette période complexe exige encore plus d’efforts et d’engagement parce qu’il est plus facile de se soucier du caractère sacré et de la cohésion de nos groupes que de nous ouvrir à un engagement universel et pourtant le Covid nous force plutôt à faire autre chose. Nous avons voulu lancer un fonds humanitaire multi-religieux précisément pour montrer que répondre ensemble à un besoin, c’est construire l’avenir commun avec intention et volonté ; les résultats sont et seront copieux : nous le savons par notre histoire et nous voulons continuer à montrer combien la collaboration interreligieuse est fructueuse. A quels défis est confronté Religions pour la Paix ? Les défis de Religions pour la Paix sont à mon avis les mêmes que ceux de toutes les institutions, non seulement religieuses, mais aussi politiques, institutionnelles, judiciaires et financières en termes de confiance, d’efficacité, de légitimité et de compétence. À mon avis, les institutions religieuses souffrent de ces crises depuis longtemps et en souffriront plus longtemps encore que les institutions civiles. Je reviens à la pandémie. Les blocus et les fermetures ont créé une rupture institutionnelle dans nos communautés. Vous pouvez bien comprendre ce que c’est que de ne plus pouvoir nous réunir, ce qui est l’une des fonctions fondamentales et essentielles de notre expérience, et que ces fonctions soient au contraire menacées par les églises, les temples, les mosquées et les synagogues qui abritaient autrefois des milliers ou des centaines de personnes et qui doivent maintenant être limitées à 50 ou quelques dizaines d’entre elles. L’absence de réunion exige donc que nous restructurions également notre service religieux et, en fait, nous nous y sommes installés, mais dans quelle mesure cela affecte-t-il la pratique religieuse ? Même ceux qui dirigent ces communautés, et pas seulement les membres, doivent reconfigurer leur rôle et la façon dont ils l’exercent dans le monde. Donc, si je lutte déjà pour survivre en tant qu’institution, comment puis-je travailler avec d’autres personnes qui ont les mêmes problèmes dans d’autres parties du monde ? Nous sommes tous interpellés par cette remise en question, les Nations unies, les gouvernements et les religions le sont aussi. Et puis il y a les menaces qui pèsent sur l’existence même des religions dans les pays et les sociétés où l’autoritarisme n’autorise pas les pratiques religieuses et où les régimes se sentent menacés dans leur fragilité intrinsèque par ces voix qui vibrent pour les droits de l’homme, la justice, le pluralisme. Pour répondre à ces défis, nous avons besoin de plus de collaboration, nous avons besoin de ressources financières, et j’ose dire que nous avons également besoin d’une plus grande conscience politique du rôle social des collaborations multi-religieuses, qui devraient également être soutenues économiquement parce qu’elles sont des espaces de service, de rencontre, de ressources uniques pour la croissance d’une société. Au lieu de cela, je constate que les religions sont souvent en marge et que si elles travaillent ensuite ensemble, elles sont généralement les dernières dans les perspectives des gouvernements. Vous avez cité la collaboration comme un pilier fondamental de l’expérience interreligieuse. Nous savons qu’il existe une collaboration de longue date entre Religions pour la Paix et le mouvement des Focolari. Comment se poursuit-il et comment mettre en œuvre ce travail commun ? C’est une longue collaboration qui est née en 1982 et qui a vu Chiara Lubich être l’une des présidentes d’honneur de Religions pour la Paix depuis 1994. Maintenant, Maria Voce continue à être l’une de nos co-présidentes depuis 2013. J’ai promis, au début de mon mandat, d’honorer tous ceux qui m’ont précédé et qui ont permis à Religions pour la Paix d’être ce qu’elle est et donc aussi à Chiara. J’ai vraiment besoin de trouver un espace, également dans notre site web, pour raconter cette amitié. Ce qui me frappe le plus dans notre lien, dans le passé et aujourd’hui, c’est que notre lien a toujours été une collaboration vitale et vivante, faite de personnes. C’est le fruit de cet héritage si, aujourd’hui encore, la communication de Religions pour la Paix est assurée par une personne des Focolari et si, au fil des ans, des membres des Focolari ont servi notre mouvement de la manière la plus variée. Tout comme le Rissho Kosei-kai. Ces collaborations interreligieuses capables de partager des ressources humaines, images du divin vivant qui honorent de leur présence l’espace sacré du dialogue sont pour moi un signe de réciprocité envers Dieu car à travers ce travail commun dans le dialogue interreligieux nous le servons, en montrant à tous la beauté de nous avoir créés de tant de religions. Comment imaginez-vous l’avenir de Religions pour la Paix ? Je l’imagine sous la bannière du multilatéralisme. Tout comme les Nations unies sont le multilatéralisme des gouvernements, je considère notre mouvement comme le multilatéralisme des religions. Après tout, en tant qu’êtres humains, nous nous engageons, au niveau micro et macro, à préserver la diversité voulue par le Créateur et à la sauvegarder pour tous, y compris les institutions. J’imagine le bénéfice que les institutions pourraient tirer de cette vision et de notre travail, et si nous travaillons ensemble, nous nous épanouirons tous les deux. Si les institutions politiques s’attachent à se sauver, si les entités religieuses s’intéressent à se sauver, cela conduira à la destruction non seulement de nos groupes mais de la planète entière. Et au lieu de cela, le pape lui-même, d’abord avec la Laudato sì et maintenant avec son encyclique, née de ce document commun avec le plus haut dirigeant sunnite qui nous appelle, est un appel commun à la sauvegarde de la terre mais surtout à la fraternité humaine inclusive de toutes les religions. Nous soutenons cette encyclique et cet appel à la fraternité ne laisse personne exclu, même pas ceux qui n’ont pas une foi, et nous nous battrons pour en faire un véritable patrimoine de toutes les religions.
Azza Karram a été élue secrétaire générale de Religions pour la Paix en août 2019. Égyptienne d’origine, de nationalité néerlandaise, professeure d’études religieuses et de diplomatie, ancienne fonctionnaire des Nations unies, âme à dimension universelle, elle est aujourd’hui à la tête d’un mouvement auquel adhèrent plus de 900 responsables religieux de 90 pays, engagés avec elle pour faire de la paix un lieu de rencontre et un chemin à suivre en communauté. Religions pour la Paix a ouvert sa première assemblée du 16 au 21 août 1970. Elle était alors dirigée par Nikkyo Niwano, un esprit de grande vision, japonais et fondateur de la Rissho Kosei-kai. Dans les années 1990, il a invité Chiara Lubich à cette assemblée mondiale : il a trouvé en elle une consonance spirituelle et pragmatique unique. Cette année, Religions pour la Paix célèbre son 50ème anniversaire. Nous avons rejoint Azza Karram à New York pour lui demander une analyse du chemin effectué et les perspectives d’avenir. 50 ans après la fondation de Religions pour la Paix, quelle mission et quel message le mouvement continue-t-il à donner ? Notre témoignage après 50 ans de vie est qu’il est inévitable que les religions travaillent ensemble au-delà des différences institutionnelles, géographiques ou doctrinales. C’est le message que nous donnons, même si nous ne le réalisons pas encore parfaitement car nous savons qu’il y a un processus d’apprentissage constant et qu’il y a aussi la fatigue de travailler ensemble. Ensuite, le Covid a mis encore plus en évidence la nécessité d’un travail commun. Les communautés religieuses ou les ONG inspirées par des valeurs religieuses le font parce qu’elles ont été les premières à répondre à cette crise humanitaire, et non d’autres. Il est vrai que les institutions de santé sont également intervenues, mais elles n’auraient pas pu le faire de manière aussi capillaire sans les institutions religieuses qui ont non seulement apporté une réponse sanitaire, financière et psychologique à cette crise, mais qui ont su se pencher sur les besoins spirituels d’une communauté et y répondent à 100% sur tous les fronts. Cependant, combien de ces institutions religieuses, tout en répondant aux besoins d’une même communauté, travaillent ensemble ? Très peu et non par manque de besoins, d’efficacité ou de connaissances. Je soupçonne parfois que nous essayons en fait de sauver nos institutions et que collaborer en cette période complexe exige encore plus d’efforts et d’engagement parce qu’il est plus facile de se soucier du caractère sacré et de la cohésion de nos groupes que de nous ouvrir à un engagement universel et pourtant le Covid nous force plutôt à faire autre chose. Nous avons voulu lancer un fonds humanitaire multi-religieux précisément pour montrer que répondre ensemble à un besoin, c’est construire l’avenir commun avec intention et volonté ; les résultats sont et seront copieux : nous le savons par notre histoire et nous voulons continuer à montrer combien la collaboration interreligieuse est fructueuse. A quels défis est confronté Religions pour la Paix ? Les défis de Religions pour la Paix sont à mon avis les mêmes que ceux de toutes les institutions, non seulement religieuses, mais aussi politiques, institutionnelles, judiciaires et financières en termes de confiance, d’efficacité, de légitimité et de compétence. À mon avis, les institutions religieuses souffrent de ces crises depuis longtemps et en souffriront plus longtemps encore que les institutions civiles. Je reviens à la pandémie. Les blocus et les fermetures ont créé une rupture institutionnelle dans nos communautés. Vous pouvez bien comprendre ce que c’est que de ne plus pouvoir nous réunir, ce qui est l’une des fonctions fondamentales et essentielles de notre expérience, et que ces fonctions soient au contraire menacées par les églises, les temples, les mosquées et les synagogues qui abritaient autrefois des milliers ou des centaines de personnes et qui doivent maintenant être limitées à 50 ou quelques dizaines d’entre elles. L’absence de réunion exige donc que nous restructurions également notre service religieux et, en fait, nous nous y sommes installés, mais dans quelle mesure cela affecte-t-il la pratique religieuse ? Même ceux qui dirigent ces communautés, et pas seulement les membres, doivent reconfigurer leur rôle et la façon dont ils l’exercent dans le monde. Donc, si je lutte déjà pour survivre en tant qu’institution, comment puis-je travailler avec d’autres personnes qui ont les mêmes problèmes dans d’autres parties du monde ? Nous sommes tous interpellés par cette remise en question, les Nations unies, les gouvernements et les religions le sont aussi. Et puis il y a les menaces qui pèsent sur l’existence même des religions dans les pays et les sociétés où l’autoritarisme n’autorise pas les pratiques religieuses et où les régimes se sentent menacés dans leur fragilité intrinsèque par ces voix qui vibrent pour les droits de l’homme, la justice, le pluralisme. Pour répondre à ces défis, nous avons besoin de plus de collaboration, nous avons besoin de ressources financières, et j’ose dire que nous avons également besoin d’une plus grande conscience politique du rôle social des collaborations multi-religieuses, qui devraient également être soutenues économiquement parce qu’elles sont des espaces de service, de rencontre, de ressources uniques pour la croissance d’une société. Au lieu de cela, je constate que les religions sont souvent en marge et que si elles travaillent ensuite ensemble, elles sont généralement les dernières dans les perspectives des gouvernements. Vous avez cité la collaboration comme un pilier fondamental de l’expérience interreligieuse. Nous savons qu’il existe une collaboration de longue date entre Religions pour la Paix et le mouvement des Focolari. Comment se poursuit-il et comment mettre en œuvre ce travail commun ? C’est une longue collaboration qui est née en 1982 et qui a vu Chiara Lubich être l’une des présidentes d’honneur de Religions pour la Paix depuis 1994. Maintenant, Maria Voce continue à être l’une de nos co-présidentes depuis 2013. J’ai promis, au début de mon mandat, d’honorer tous ceux qui m’ont précédé et qui ont permis à Religions pour la Paix d’être ce qu’elle est et donc aussi à Chiara. J’ai vraiment besoin de trouver un espace, également dans notre site web, pour raconter cette amitié. Ce qui me frappe le plus dans notre lien, dans le passé et aujourd’hui, c’est que notre lien a toujours été une collaboration vitale et vivante, faite de personnes. C’est le fruit de cet héritage si, aujourd’hui encore, la communication de Religions pour la Paix est assurée par une personne des Focolari et si, au fil des ans, des membres des Focolari ont servi notre mouvement de la manière la plus variée. Tout comme le Rissho Kosei-kai. Ces collaborations interreligieuses capables de partager des ressources humaines, images du divin vivant qui honorent de leur présence l’espace sacré du dialogue sont pour moi un signe de réciprocité envers Dieu car à travers ce travail commun dans le dialogue interreligieux nous le servons, en montrant à tous la beauté de nous avoir créés de tant de religions. Comment imaginez-vous l’avenir de Religions pour la Paix ? Je l’imagine sous la bannière du multilatéralisme. Tout comme les Nations unies sont le multilatéralisme des gouvernements, je considère notre mouvement comme le multilatéralisme des religions. Après tout, en tant qu’êtres humains, nous nous engageons, au niveau micro et macro, à préserver la diversité voulue par le Créateur et à la sauvegarder pour tous, y compris les institutions. J’imagine le bénéfice que les institutions pourraient tirer de cette vision et de notre travail, et si nous travaillons ensemble, nous nous épanouirons tous les deux. Si les institutions politiques s’attachent à se sauver, si les entités religieuses s’intéressent à se sauver, cela conduira à la destruction non seulement de nos groupes mais de la planète entière. Et au lieu de cela, le pape lui-même, d’abord avec la Laudato sì et maintenant avec son encyclique, née de ce document commun avec le plus haut dirigeant sunnite qui nous appelle, est un appel commun à la sauvegarde de la terre mais surtout à la fraternité humaine inclusive de toutes les religions. Nous soutenons cette encyclique et cet appel à la fraternité ne laisse personne exclu, même pas ceux qui n’ont pas une foi, et nous nous battrons pour en faire un véritable patrimoine de toutes les religions.
Aux soins de Maddalena Maltese
Nov 23, 2020 | Non classifié(e)
La souffrance maître de sagesse. C’est la conviction que Chiara Lubich exprime dans la réflexion qui suit. Nous devons approcher ceux qui souffrent non seulement avec compassion mais dans une attitude de déférence et d’écoute. Pourquoi un homme ignorant les sciences, même religieuses, est-il devenu saint avec seulement le livre du Crucifié ? Parce qu’il ne s’est pas arrêté pour le contempler ou pour le vénérer, et en embrasser les plaies, mais qu’il a voulu le revivre en lui-même. Celui qui souffre et qui est dans l’obscurité voit plus loin que celui qui ne souffre pas, tout comme le soleil doit se coucher pour qu’on voie les étoiles. La souffrance enseigne ce que l’on ne peut apprendre d’aucune autre manière. Elle siège sur la plus haute chaire. C’est un maître de sagesse, et celui qui a la sagesse est bienheureux (cf. Pr 3, 13). « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés » (Mt 5, 4), non seulement par la récompense de l’au-delà, mais également par la contemplation des choses célestes ici-bas. Il est nécessaire d’approcher ceux qui souffrent avec le respect, et plus encore, avec lequel on approchait un temps les aînés, quand on attendait d’eux la sagesse.
Chiara Lubich
Chiara Lubich, Vede più lontano. Scritti Spirituali/2, Città Nuova Editrice – Rome, 1997, p. 78.
Nov 20, 2020 | Non classifié(e)
Jésus n’est pas indifférent à nos tribulations et s’engage à guérir nos cœurs de la dureté de l’égoïsme, à remplir notre solitude, à donner de la force à notre action. Un couple sauvé L’une de nos filles traversait un moment extrêmement délicat dans sa vie de couple. La dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, elle m’a confié qu’elle avait désormais perdu tout espoir de sauver son mariage ; la seule chose à faire, m’a-t-elle dit en pleurant, était de divorcer. Mon mari et moi avions toujours été frappés par la promesse que Jésus avait faite aux disciples : « Si deux d’entre vous sur la terre s’accordent pour demander quelque chose, mon Père qui est aux cieux vous l’accordera. » Avec cette confiance, j’ai promis à notre fille qu’avec ses cinq autres frères, nous prierions pour la réconciliation. Peu de temps après, elle m’a appelé, presque incrédule : après mûre réflexion, son mari avait accepté de s’entretenir avec ceux qui pourraient les aider à résoudre leurs problèmes. En fait, ils se sont réconciliés. Et ce n’est pas tout : après quelques années, notre gendre lui a manifesté son désir de faire partie de l’Église catholique. C’est pourquoi il lui a demandé de l’accompagner chez un prêtre pour commencer la préparation nécessaire. (G. B. – Usa) Un nouveau départ J’avais hâte de commencer à enseigner dans un lycée de l’Église d’Angleterre, dans un quartier à l’ouest de Londres. Mais mon enthousiasme s’est vite dissipé : déçu par l’accueil des élèves et en conflit avec eux, j’ai commencé à utiliser mes pouvoirs. Mais en me confiant à des amis, je me suis rendu compte qu’il me fallait suivre une autre voie, même si je me sentais du bon côté. Jésus ne ferait pas cela. Le lendemain, en classe, je me suis excusé en disant que j’avais probablement fait beaucoup d’erreurs qu’un professeur plus expérimenté aurait évitées. Dans un grand silence et en écoutant les élèves, j’ai dit que j’essaierai de les voir tous avec des yeux nouveaux, en espérant qu’ils feraient de même avec moi. L’un des principaux fauteurs de troubles a accepté publiquement mes excuses, s’excusant à son tour pour son propre comportement et celui du reste de la classe. À ces mots,plusieurs élèves ont aquiescé. J’ai vu certains d’entre eux sourire. Quelque chose d’imprévisible s’était produit : un professeur s’était excusé devant toute la classe. C’était un nouveau départ pour tout le monde. (G.P. – Angleterre) Le gars du carrefour Chaque matin, avant de me rendre sur mon lieu de travail en tant qu’agent de la circulation, je vais généralement à la messe et je demande à Jésus de m’aider à aimer tous ceux que je rencontre pendant la journée. Un jour, à un carrefour très fréquenté, je vois un jeune en moto filer à toute allure. Au bout d’un certain temps, il revient, toujours à très grande vitesse, et cela se répète plusieurs fois. Je lui dis en vain d’arrêter, en espérant dans mon cœur qu’il ne causera pas de problèmes. Finalement, il s’arrête, juste pour me dire : “J’ai beaucoup de difficultés, je veux en finir”. Je l’écoute un bon moment, tout en continuant mon travail. Je lui propose mon aide, et je ne lui donne pas d’amende. Je le vois s’en aller plus paisiblement. Quelques années passent. Alors que je suis en service dans un autre lieu, un jeune homme souriant s’approche de moi et m’embrasse, ému. Je lui dis : “Écoutez, vous devez vous être tropmé de gendarme.” Et il dit : « Non, je suis le gars du carrefour ; maintenant, je suis heureux en mariage et dans la vie. J’ai fait tout le trajet depuis la ville où j’habite maintenant, parce que je voulais vous remercier. » Dans mon cœur, je ne peux que remercier Dieu. (S.A. – Italie)
Stefania Tanesini
(extrait de Il Vangelo del Giorno, Città Nuova, année VI, n°6, novembre-décembre 2020)

Nov 18, 2020 | Non classifié(e)
Conçue comme l’un des événements du Centenaire de Chiara Lubich, elle avait été suspendue en raison de la pandémie et les fonds collectés avaient été reversés à des œuvres de charité. Elle arrive maintenant sur les sites sociaux des Focolari au Brésil avec le même contenu et de nouveaux langages. Une exposition prévue pour août 2020, puis reportée à novembre et enfin aboutie sur le web. Un itinéraire laborieux pour cet événement dédié à Chiara Lubich à l’occasion du Centenaire de sa naissance et désormais accessible à travers les profils sociaux de @focolaresbrasil (Facebook, Instagram et Youtube) : photos, vidéos et contenus textuels seront publiés quotidiennement tout au long du mois de novembre 2020. Une exposition différente de celle qui avait été prévue, avec un public plus large grâce au web, enrichie par la contribution d’une équipe intergénérationnelle. Nous en parlons avec Josè Portella, un des responsables de l’exposition.  Comment est née l’idée de remplacer l’exposition en présence par une exposition virtuelle ? Qui a fait partie de l’équipe de réalisation et comment avez-vous travaillé ? Nous sommes une équipe de seize personnes du Mouvement des Focolari, d’âges et de vocations différents : jeunes et adultes, volontaires et focolarini. Dès le début de 2019, nous avons travaillé ensemble pour présenter au Brésil une version réduite de l’exposition organisée aux Galeries de Trente en Italie. Puis, la pandémie est arrivée. En mai 2020, réalisant la gravité de la situation, nous avons compris que nous pouvions « célébrer » le Centenaire en aidant les personnes dans le besoin touchées par la pandémie. En accord avec les personnes qui avaient déjà fait des dons pour l’exposition, nous avons fait don de ce que nous avions reçu à ceux qui en avaient le plus besoin. C’est alors que nous avons appris qu’un parcours en ligne était en préparation pour l’exposition à Trente. Mais la simple traduction n’a pas suffi pour atteindre la réalité brésilienne. Pourquoi ne pas faire quelque chose de virtuellement spécifique pour notre pays ? Avec quelques experts des nouvelles générations qui ont rejoint l’équipe, nous nous sommes divisés en trois groupes pour adapter le matériel d’exposition de Trente, préparer des vidéos et évaluer les besoins financiers. Une expérience d’unité entre les générations. La principale difficulté a été de maintenir le récit de l’exposition de Trente, mais avec une approche brésilienne et un langage adapté aux réseaux sociaux. Quelles sont les caractéristiques du parcours que vous avez réservé aux visiteurs virtuels ? Il y a quatre vidéos promotionnelles et une vidéo pour le lancement de l’Exposition. Ensuite, Chiara Lubich et son charisme sont présentés selon trois thèmes : être avec l’histoire de Lubich ; influer avec le témoignage des personnes qui ont connu et qui vivent la spiritualité de l’unité ; agir avec toutes les réalités qui sont nées de son charisme. Que pensez-vous que Chiara Lubich ait à dire au Brésil d’aujourd’hui, même en cette période particulière de pandémie que nous vivons au niveau planétaire ? Chiara Lubich, lors d’un voyage au Brésil en 1991, face à l’inégalité qu’elle a constatée, a eu l’intuition de l’Économie de communion et a affirmé que le Mouvement au Brésil est appelé à agir sur la communion des biens au niveau mondial. Aujourd’hui, dans le contexte de la pandémie, incarner ce charisme signifie prendre soin des autres, partager non seulement les biens matériels, mais aussi consacrer sa vie au service des autres, ne pas se demander qui est mon prochain, mais de qui suis-je moi, le prochain. Conformément à l’encyclique du pape François « Tous frères », nous sommes appelés en tant que peuple à agir en fraternité, à l’instar du bon samaritain. Ce n’est qu’alors que des hommes nouveaux émergeront pour construire une société plus inclusive et plus fraternelle.
Comment est née l’idée de remplacer l’exposition en présence par une exposition virtuelle ? Qui a fait partie de l’équipe de réalisation et comment avez-vous travaillé ? Nous sommes une équipe de seize personnes du Mouvement des Focolari, d’âges et de vocations différents : jeunes et adultes, volontaires et focolarini. Dès le début de 2019, nous avons travaillé ensemble pour présenter au Brésil une version réduite de l’exposition organisée aux Galeries de Trente en Italie. Puis, la pandémie est arrivée. En mai 2020, réalisant la gravité de la situation, nous avons compris que nous pouvions « célébrer » le Centenaire en aidant les personnes dans le besoin touchées par la pandémie. En accord avec les personnes qui avaient déjà fait des dons pour l’exposition, nous avons fait don de ce que nous avions reçu à ceux qui en avaient le plus besoin. C’est alors que nous avons appris qu’un parcours en ligne était en préparation pour l’exposition à Trente. Mais la simple traduction n’a pas suffi pour atteindre la réalité brésilienne. Pourquoi ne pas faire quelque chose de virtuellement spécifique pour notre pays ? Avec quelques experts des nouvelles générations qui ont rejoint l’équipe, nous nous sommes divisés en trois groupes pour adapter le matériel d’exposition de Trente, préparer des vidéos et évaluer les besoins financiers. Une expérience d’unité entre les générations. La principale difficulté a été de maintenir le récit de l’exposition de Trente, mais avec une approche brésilienne et un langage adapté aux réseaux sociaux. Quelles sont les caractéristiques du parcours que vous avez réservé aux visiteurs virtuels ? Il y a quatre vidéos promotionnelles et une vidéo pour le lancement de l’Exposition. Ensuite, Chiara Lubich et son charisme sont présentés selon trois thèmes : être avec l’histoire de Lubich ; influer avec le témoignage des personnes qui ont connu et qui vivent la spiritualité de l’unité ; agir avec toutes les réalités qui sont nées de son charisme. Que pensez-vous que Chiara Lubich ait à dire au Brésil d’aujourd’hui, même en cette période particulière de pandémie que nous vivons au niveau planétaire ? Chiara Lubich, lors d’un voyage au Brésil en 1991, face à l’inégalité qu’elle a constatée, a eu l’intuition de l’Économie de communion et a affirmé que le Mouvement au Brésil est appelé à agir sur la communion des biens au niveau mondial. Aujourd’hui, dans le contexte de la pandémie, incarner ce charisme signifie prendre soin des autres, partager non seulement les biens matériels, mais aussi consacrer sa vie au service des autres, ne pas se demander qui est mon prochain, mais de qui suis-je moi, le prochain. Conformément à l’encyclique du pape François « Tous frères », nous sommes appelés en tant que peuple à agir en fraternité, à l’instar du bon samaritain. Ce n’est qu’alors que des hommes nouveaux émergeront pour construire une société plus inclusive et plus fraternelle.
D’après Anna Lisa Innocenti
Nov 16, 2020 | Non classifié(e)
Dans la spiritualité de l’unité, la personne ne cherche pas seulement Dieu au fond de son âme, mais elle découvre sa présence dans l’espace qu’elle ouvre lorsque deux ou plusieurs personnes s’aiment comme l’Évangile l’enseigne. Chiara Lubich, pour décrire cette réalité, utilise une image, celle d’un château : non pas intérieur, mais extérieur. Pour ceux qui empruntent la voie de l’unité, la présence de Jésus au milieu des frères est essentielle. Si on ne veut pas connaître un échec personnel, il faut que sa présence soit toujours vivante. Et cette présence caractérise le charisme de l’unité. De même que la lumière électrique ne s’allume pas tant que ses deux pôles ne sont pas en contact, mais s’allume dès qu’ils le sont, de même deux personnes ne peuvent faire l’expérience de la lumière spécifique de ce charisme tant qu’elles ne s’unissent pas en Christ à travers la charité. Dans cette voie de l’unité, tout – travail, études, prière et recherche de la sainteté, rayonnement de la vie chrétienne – acquiert un sens et une valeur s’il y a la présence de Jésus au milieu des frères, qui est le principe par excellence de cette vie. Dans cette spiritualité, on parvient à la sainteté si on marche vers Dieu en unité. […] Sainte Thérèse d’Avila, docteur de l’Église, parle de la réalité de l’âme habitée par la majesté de Dieu comme d’un « château intérieur », qu’il faut découvrir et éclairer petit à petit au cours de la vie, en surmontant diverses épreuves. C’est là un sommet de sainteté dans une voie avant tout individuelle, même si Thérèse entraînait dans cette expérience beaucoup de jeunes filles. Le moment nous semble venu de découvrir, d’éclairer et de construire non seulement ce « château intérieur », mais aussi un « château extérieur ». […] En réfléchissant au fait que cette nouvelle spiritualité parvient jusqu’aux responsables de la société et de l’Église, on se rend compte que ce charisme[…] tend à le faire (ce château extérieur également) de tout le corps social et ecclésial. Récemment, Jean-Paul II, s’adressant à près de soixante-dix évêques, amis du Mouvement, disait : « Le Seigneur Jésus […] n’a pas appelé les disciples à le suivre de manière individuelle, mais d’une manière indissociablement personnelle et communautaire. Et si cela est vrai pour tous les baptisés – continue le Pape – cela vaut de façon particulière […] pour les apôtres et leurs successeurs, les évêques[1]. » Ainsi cette spiritualité, comme tous les charismes, est faite pour tout le peuple de Dieu, dont la vocation est d’être toujours plus un et plus saint.
Chiara Lubich
Extrait de : Une spiritualité de communion. In : Chiara Lubich, Pensée et spiritualité, Nouvelle Cité 2003, p. 70. [1] Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVIII (1995)1, Città del Vaticano 1997, p. 382.
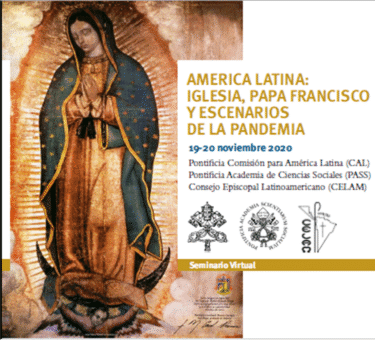
Nov 14, 2020 | Non classifié(e)
Un webinaire promu par la commission pontificale pour l’Amérique latine ouvert à tous pour réfléchir et analyser l’impact et les conséquences de COVID-19. Les implications sociales, économiques et politiques et la pensée du pape François. 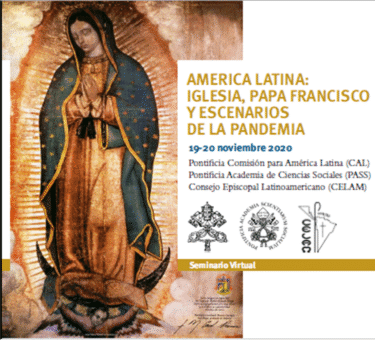 Le séminaire virtuel intitulé Amérique latine : l’Église, le pape François et le tableau de la pandémie (site en espagnol) aura lieu les 19 et 20 novembre et sera ouvert à tous ceux qui s’intéressent à cette partie du monde, également fortement touchée par le virus ; un tableau déjà compliqué dans de nombreux territoires pauvres et marginalisés. Organisée par la Commission pontificale pour l’Amérique latine, l’Académie pontificale des Sciences Sociales et la Conférence Épiscopale Latino-Américaine (CELAM), cette rencontre a pour but de réfléchir et d’analyser la situation de la pandémie sur le continent latino-américain, ses conséquences et, surtout, les lignes d’action et l’aide des gouvernements et de l’Église. Le Pape se rendra présent par un message vidéo et une carte. Plusieurs intervenants sont prévus : le cardinal Marc Ouellet, Président de la Commission pontificale pour l’Amérique latine, Mgr Miguel Cabrejos Vidarte, Président du CELAM, Carlos Afonso Nobre, prix Nobel de la paix en 2007, l’économiste Jeffrey D. Sachs, Directeur du Centre pour le développement durable de l’Université de Columbia et Gustavo Beliz, Secrétaire aux Affaires Stratégiques de la Présidence Argentine. La note introductive au séminaire explique qu’à ce jour, sur le continent latino-américain comme dans le reste du monde, il est impossible d’évaluer les dommages causés par la pandémie : « Dans de nombreux cas, les effets négatifs de la fermeture des frontières et les répercussions sociales et économiques qui en découlent n’ont été que le début d’une spirale de dommages non encore quantifiés, on est encore loin de pouvoir énoncer des recommandations pour une solution à moyen terme. » C’est pourquoi le séminaire sera l’occasion d’une rencontre et d’un dialogue entre l’action missionnaire et pastorale de l’Église catholique et la contribution de divers spécialistes du monde économique et politique, afin de renforcer un réseau culturel et opérationnel et de garantir ainsi un meilleur avenir pour le continent. Le pape François sera également présent avec la présentation de la Task Force contre Covid-19, créée par lui et représentée au séminaire par son responsable qui en exposera les travaux. En ces temps d’incertitude et de manque d’avenir, l’Église se tourne vers le “continent de l’espoir” et cherche à partager des outils communs qui puissent tirer parti de la crise ou du moins trouver des moyens d’en sortir. Programme + inscription à l’événement (site en espagnol)
Le séminaire virtuel intitulé Amérique latine : l’Église, le pape François et le tableau de la pandémie (site en espagnol) aura lieu les 19 et 20 novembre et sera ouvert à tous ceux qui s’intéressent à cette partie du monde, également fortement touchée par le virus ; un tableau déjà compliqué dans de nombreux territoires pauvres et marginalisés. Organisée par la Commission pontificale pour l’Amérique latine, l’Académie pontificale des Sciences Sociales et la Conférence Épiscopale Latino-Américaine (CELAM), cette rencontre a pour but de réfléchir et d’analyser la situation de la pandémie sur le continent latino-américain, ses conséquences et, surtout, les lignes d’action et l’aide des gouvernements et de l’Église. Le Pape se rendra présent par un message vidéo et une carte. Plusieurs intervenants sont prévus : le cardinal Marc Ouellet, Président de la Commission pontificale pour l’Amérique latine, Mgr Miguel Cabrejos Vidarte, Président du CELAM, Carlos Afonso Nobre, prix Nobel de la paix en 2007, l’économiste Jeffrey D. Sachs, Directeur du Centre pour le développement durable de l’Université de Columbia et Gustavo Beliz, Secrétaire aux Affaires Stratégiques de la Présidence Argentine. La note introductive au séminaire explique qu’à ce jour, sur le continent latino-américain comme dans le reste du monde, il est impossible d’évaluer les dommages causés par la pandémie : « Dans de nombreux cas, les effets négatifs de la fermeture des frontières et les répercussions sociales et économiques qui en découlent n’ont été que le début d’une spirale de dommages non encore quantifiés, on est encore loin de pouvoir énoncer des recommandations pour une solution à moyen terme. » C’est pourquoi le séminaire sera l’occasion d’une rencontre et d’un dialogue entre l’action missionnaire et pastorale de l’Église catholique et la contribution de divers spécialistes du monde économique et politique, afin de renforcer un réseau culturel et opérationnel et de garantir ainsi un meilleur avenir pour le continent. Le pape François sera également présent avec la présentation de la Task Force contre Covid-19, créée par lui et représentée au séminaire par son responsable qui en exposera les travaux. En ces temps d’incertitude et de manque d’avenir, l’Église se tourne vers le “continent de l’espoir” et cherche à partager des outils communs qui puissent tirer parti de la crise ou du moins trouver des moyens d’en sortir. Programme + inscription à l’événement (site en espagnol)
Stefania Tanesini

 Azza Karram a été élue secrétaire générale de Religions pour la Paix en août 2019. Égyptienne d’origine, de nationalité néerlandaise, professeure d’études religieuses et de diplomatie, ancienne fonctionnaire des Nations unies, âme à dimension universelle, elle est aujourd’hui à la tête d’un mouvement auquel adhèrent plus de 900 responsables religieux de 90 pays, engagés avec elle pour faire de la paix un lieu de rencontre et un chemin à suivre en communauté. Religions pour la Paix a ouvert sa première assemblée du 16 au 21 août 1970. Elle était alors dirigée par Nikkyo Niwano, un esprit de grande vision, japonais et fondateur de la Rissho Kosei-kai. Dans les années 1990, il a invité Chiara Lubich à cette assemblée mondiale : il a trouvé en elle une consonance spirituelle et pragmatique unique. Cette année, Religions pour la Paix célèbre son 50ème anniversaire. Nous avons rejoint Azza Karram à New York pour lui demander une analyse du chemin effectué et les perspectives d’avenir. 50 ans après la fondation de Religions pour la Paix, quelle mission et quel message le mouvement continue-t-il à donner ? Notre témoignage après 50 ans de vie est qu’il est inévitable que les religions travaillent ensemble au-delà des différences institutionnelles, géographiques ou doctrinales. C’est le message que nous donnons, même si nous ne le réalisons pas encore parfaitement car nous savons qu’il y a un processus d’apprentissage constant et qu’il y a aussi la fatigue de travailler ensemble. Ensuite, le Covid a mis encore plus en évidence la nécessité d’un travail commun. Les communautés religieuses ou les ONG inspirées par des valeurs religieuses le font parce qu’elles ont été les premières à répondre à cette crise humanitaire, et non d’autres. Il est vrai que les institutions de santé sont également intervenues, mais elles n’auraient pas pu le faire de manière aussi capillaire sans les institutions religieuses qui ont non seulement apporté une réponse sanitaire, financière et psychologique à cette crise, mais qui ont su se pencher sur les besoins spirituels d’une communauté et y répondent à 100% sur tous les fronts. Cependant, combien de ces institutions religieuses, tout en répondant aux besoins d’une même communauté, travaillent ensemble ? Très peu et non par manque de besoins, d’efficacité ou de connaissances. Je soupçonne parfois que nous essayons en fait de sauver nos institutions et que collaborer en cette période complexe exige encore plus d’efforts et d’engagement parce qu’il est plus facile de se soucier du caractère sacré et de la cohésion de nos groupes que de nous ouvrir à un engagement universel et pourtant le Covid nous force plutôt à faire autre chose. Nous avons voulu lancer un fonds humanitaire multi-religieux précisément pour montrer que répondre ensemble à un besoin, c’est construire l’avenir commun avec intention et volonté ; les résultats sont et seront copieux : nous le savons par notre histoire et nous voulons continuer à montrer combien la collaboration interreligieuse est fructueuse. A quels défis est confronté Religions pour la Paix ? Les défis de Religions pour la Paix sont à mon avis les mêmes que ceux de toutes les institutions, non seulement religieuses, mais aussi politiques, institutionnelles, judiciaires et financières en termes de confiance, d’efficacité, de légitimité et de compétence. À mon avis, les institutions religieuses souffrent de ces crises depuis longtemps et en souffriront plus longtemps encore que les institutions civiles. Je reviens à la pandémie. Les blocus et les fermetures ont créé une rupture institutionnelle dans nos communautés. Vous pouvez bien comprendre ce que c’est que de ne plus pouvoir nous réunir, ce qui est l’une des fonctions fondamentales et essentielles de notre expérience, et que ces fonctions soient au contraire menacées par les églises, les temples, les mosquées et les synagogues qui abritaient autrefois des milliers ou des centaines de personnes et qui doivent maintenant être limitées à 50 ou quelques dizaines d’entre elles. L’absence de réunion exige donc que nous restructurions également notre service religieux et, en fait, nous nous y sommes installés, mais dans quelle mesure cela affecte-t-il la pratique religieuse ? Même ceux qui dirigent ces communautés, et pas seulement les membres, doivent reconfigurer leur rôle et la façon dont ils l’exercent dans le monde. Donc, si je lutte déjà pour survivre en tant qu’institution, comment puis-je travailler avec d’autres personnes qui ont les mêmes problèmes dans d’autres parties du monde ? Nous sommes tous interpellés par cette remise en question, les Nations unies, les gouvernements et les religions le sont aussi. Et puis il y a les menaces qui pèsent sur l’existence même des religions dans les pays et les sociétés où l’autoritarisme n’autorise pas les pratiques religieuses et où les régimes se sentent menacés dans leur fragilité intrinsèque par ces voix qui vibrent pour les droits de l’homme, la justice, le pluralisme. Pour répondre à ces défis, nous avons besoin de plus de collaboration, nous avons besoin de ressources financières, et j’ose dire que nous avons également besoin d’une plus grande conscience politique du rôle social des collaborations multi-religieuses, qui devraient également être soutenues économiquement parce qu’elles sont des espaces de service, de rencontre, de ressources uniques pour la croissance d’une société. Au lieu de cela, je constate que les religions sont souvent en marge et que si elles travaillent ensuite ensemble, elles sont généralement les dernières dans les perspectives des gouvernements. Vous avez cité la collaboration comme un pilier fondamental de l’expérience interreligieuse. Nous savons qu’il existe une collaboration de longue date entre Religions pour la Paix et le mouvement des Focolari. Comment se poursuit-il et comment mettre en œuvre ce travail commun ? C’est une longue collaboration qui est née en 1982 et qui a vu Chiara Lubich être l’une des présidentes d’honneur de Religions pour la Paix depuis 1994. Maintenant, Maria Voce continue à être l’une de nos co-présidentes depuis 2013. J’ai promis, au début de mon mandat, d’honorer tous ceux qui m’ont précédé et qui ont permis à Religions pour la Paix d’être ce qu’elle est et donc aussi à Chiara. J’ai vraiment besoin de trouver un espace, également dans notre site web, pour raconter cette amitié. Ce qui me frappe le plus dans notre lien, dans le passé et aujourd’hui, c’est que notre lien a toujours été une collaboration vitale et vivante, faite de personnes. C’est le fruit de cet héritage si, aujourd’hui encore, la communication de Religions pour la Paix est assurée par une personne des Focolari et si, au fil des ans, des membres des Focolari ont servi notre mouvement de la manière la plus variée. Tout comme le Rissho Kosei-kai. Ces collaborations interreligieuses capables de partager des ressources humaines, images du divin vivant qui honorent de leur présence l’espace sacré du dialogue sont pour moi un signe de réciprocité envers Dieu car à travers ce travail commun dans le dialogue interreligieux nous le servons, en montrant à tous la beauté de nous avoir créés de tant de religions. Comment imaginez-vous l’avenir de Religions pour la Paix ? Je l’imagine sous la bannière du multilatéralisme. Tout comme les Nations unies sont le multilatéralisme des gouvernements, je considère notre mouvement comme le multilatéralisme des religions. Après tout, en tant qu’êtres humains, nous nous engageons, au niveau micro et macro, à préserver la diversité voulue par le Créateur et à la sauvegarder pour tous, y compris les institutions. J’imagine le bénéfice que les institutions pourraient tirer de cette vision et de notre travail, et si nous travaillons ensemble, nous nous épanouirons tous les deux. Si les institutions politiques s’attachent à se sauver, si les entités religieuses s’intéressent à se sauver, cela conduira à la destruction non seulement de nos groupes mais de la planète entière. Et au lieu de cela, le pape lui-même, d’abord avec la Laudato sì et maintenant avec son encyclique, née de ce document commun avec le plus haut dirigeant sunnite qui nous appelle, est un appel commun à la sauvegarde de la terre mais surtout à la fraternité humaine inclusive de toutes les religions. Nous soutenons cette encyclique et cet appel à la fraternité ne laisse personne exclu, même pas ceux qui n’ont pas une foi, et nous nous battrons pour en faire un véritable patrimoine de toutes les religions.
Azza Karram a été élue secrétaire générale de Religions pour la Paix en août 2019. Égyptienne d’origine, de nationalité néerlandaise, professeure d’études religieuses et de diplomatie, ancienne fonctionnaire des Nations unies, âme à dimension universelle, elle est aujourd’hui à la tête d’un mouvement auquel adhèrent plus de 900 responsables religieux de 90 pays, engagés avec elle pour faire de la paix un lieu de rencontre et un chemin à suivre en communauté. Religions pour la Paix a ouvert sa première assemblée du 16 au 21 août 1970. Elle était alors dirigée par Nikkyo Niwano, un esprit de grande vision, japonais et fondateur de la Rissho Kosei-kai. Dans les années 1990, il a invité Chiara Lubich à cette assemblée mondiale : il a trouvé en elle une consonance spirituelle et pragmatique unique. Cette année, Religions pour la Paix célèbre son 50ème anniversaire. Nous avons rejoint Azza Karram à New York pour lui demander une analyse du chemin effectué et les perspectives d’avenir. 50 ans après la fondation de Religions pour la Paix, quelle mission et quel message le mouvement continue-t-il à donner ? Notre témoignage après 50 ans de vie est qu’il est inévitable que les religions travaillent ensemble au-delà des différences institutionnelles, géographiques ou doctrinales. C’est le message que nous donnons, même si nous ne le réalisons pas encore parfaitement car nous savons qu’il y a un processus d’apprentissage constant et qu’il y a aussi la fatigue de travailler ensemble. Ensuite, le Covid a mis encore plus en évidence la nécessité d’un travail commun. Les communautés religieuses ou les ONG inspirées par des valeurs religieuses le font parce qu’elles ont été les premières à répondre à cette crise humanitaire, et non d’autres. Il est vrai que les institutions de santé sont également intervenues, mais elles n’auraient pas pu le faire de manière aussi capillaire sans les institutions religieuses qui ont non seulement apporté une réponse sanitaire, financière et psychologique à cette crise, mais qui ont su se pencher sur les besoins spirituels d’une communauté et y répondent à 100% sur tous les fronts. Cependant, combien de ces institutions religieuses, tout en répondant aux besoins d’une même communauté, travaillent ensemble ? Très peu et non par manque de besoins, d’efficacité ou de connaissances. Je soupçonne parfois que nous essayons en fait de sauver nos institutions et que collaborer en cette période complexe exige encore plus d’efforts et d’engagement parce qu’il est plus facile de se soucier du caractère sacré et de la cohésion de nos groupes que de nous ouvrir à un engagement universel et pourtant le Covid nous force plutôt à faire autre chose. Nous avons voulu lancer un fonds humanitaire multi-religieux précisément pour montrer que répondre ensemble à un besoin, c’est construire l’avenir commun avec intention et volonté ; les résultats sont et seront copieux : nous le savons par notre histoire et nous voulons continuer à montrer combien la collaboration interreligieuse est fructueuse. A quels défis est confronté Religions pour la Paix ? Les défis de Religions pour la Paix sont à mon avis les mêmes que ceux de toutes les institutions, non seulement religieuses, mais aussi politiques, institutionnelles, judiciaires et financières en termes de confiance, d’efficacité, de légitimité et de compétence. À mon avis, les institutions religieuses souffrent de ces crises depuis longtemps et en souffriront plus longtemps encore que les institutions civiles. Je reviens à la pandémie. Les blocus et les fermetures ont créé une rupture institutionnelle dans nos communautés. Vous pouvez bien comprendre ce que c’est que de ne plus pouvoir nous réunir, ce qui est l’une des fonctions fondamentales et essentielles de notre expérience, et que ces fonctions soient au contraire menacées par les églises, les temples, les mosquées et les synagogues qui abritaient autrefois des milliers ou des centaines de personnes et qui doivent maintenant être limitées à 50 ou quelques dizaines d’entre elles. L’absence de réunion exige donc que nous restructurions également notre service religieux et, en fait, nous nous y sommes installés, mais dans quelle mesure cela affecte-t-il la pratique religieuse ? Même ceux qui dirigent ces communautés, et pas seulement les membres, doivent reconfigurer leur rôle et la façon dont ils l’exercent dans le monde. Donc, si je lutte déjà pour survivre en tant qu’institution, comment puis-je travailler avec d’autres personnes qui ont les mêmes problèmes dans d’autres parties du monde ? Nous sommes tous interpellés par cette remise en question, les Nations unies, les gouvernements et les religions le sont aussi. Et puis il y a les menaces qui pèsent sur l’existence même des religions dans les pays et les sociétés où l’autoritarisme n’autorise pas les pratiques religieuses et où les régimes se sentent menacés dans leur fragilité intrinsèque par ces voix qui vibrent pour les droits de l’homme, la justice, le pluralisme. Pour répondre à ces défis, nous avons besoin de plus de collaboration, nous avons besoin de ressources financières, et j’ose dire que nous avons également besoin d’une plus grande conscience politique du rôle social des collaborations multi-religieuses, qui devraient également être soutenues économiquement parce qu’elles sont des espaces de service, de rencontre, de ressources uniques pour la croissance d’une société. Au lieu de cela, je constate que les religions sont souvent en marge et que si elles travaillent ensuite ensemble, elles sont généralement les dernières dans les perspectives des gouvernements. Vous avez cité la collaboration comme un pilier fondamental de l’expérience interreligieuse. Nous savons qu’il existe une collaboration de longue date entre Religions pour la Paix et le mouvement des Focolari. Comment se poursuit-il et comment mettre en œuvre ce travail commun ? C’est une longue collaboration qui est née en 1982 et qui a vu Chiara Lubich être l’une des présidentes d’honneur de Religions pour la Paix depuis 1994. Maintenant, Maria Voce continue à être l’une de nos co-présidentes depuis 2013. J’ai promis, au début de mon mandat, d’honorer tous ceux qui m’ont précédé et qui ont permis à Religions pour la Paix d’être ce qu’elle est et donc aussi à Chiara. J’ai vraiment besoin de trouver un espace, également dans notre site web, pour raconter cette amitié. Ce qui me frappe le plus dans notre lien, dans le passé et aujourd’hui, c’est que notre lien a toujours été une collaboration vitale et vivante, faite de personnes. C’est le fruit de cet héritage si, aujourd’hui encore, la communication de Religions pour la Paix est assurée par une personne des Focolari et si, au fil des ans, des membres des Focolari ont servi notre mouvement de la manière la plus variée. Tout comme le Rissho Kosei-kai. Ces collaborations interreligieuses capables de partager des ressources humaines, images du divin vivant qui honorent de leur présence l’espace sacré du dialogue sont pour moi un signe de réciprocité envers Dieu car à travers ce travail commun dans le dialogue interreligieux nous le servons, en montrant à tous la beauté de nous avoir créés de tant de religions. Comment imaginez-vous l’avenir de Religions pour la Paix ? Je l’imagine sous la bannière du multilatéralisme. Tout comme les Nations unies sont le multilatéralisme des gouvernements, je considère notre mouvement comme le multilatéralisme des religions. Après tout, en tant qu’êtres humains, nous nous engageons, au niveau micro et macro, à préserver la diversité voulue par le Créateur et à la sauvegarder pour tous, y compris les institutions. J’imagine le bénéfice que les institutions pourraient tirer de cette vision et de notre travail, et si nous travaillons ensemble, nous nous épanouirons tous les deux. Si les institutions politiques s’attachent à se sauver, si les entités religieuses s’intéressent à se sauver, cela conduira à la destruction non seulement de nos groupes mais de la planète entière. Et au lieu de cela, le pape lui-même, d’abord avec la Laudato sì et maintenant avec son encyclique, née de ce document commun avec le plus haut dirigeant sunnite qui nous appelle, est un appel commun à la sauvegarde de la terre mais surtout à la fraternité humaine inclusive de toutes les religions. Nous soutenons cette encyclique et cet appel à la fraternité ne laisse personne exclu, même pas ceux qui n’ont pas une foi, et nous nous battrons pour en faire un véritable patrimoine de toutes les religions.