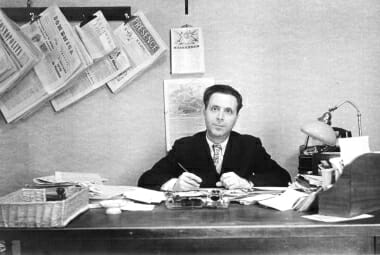Mar 2, 2015 | Non classifié(e)
 Un conseiller communal, chef de file du parti de la majorité de la ville argentine de Mar del Plata (Argentine), voit entrer dans son bureau deux jeunes qui se présentent comme des activistes de l’opposition. Le conseiller, curieux, les reçoit. Avec simplicité les deux jeunes expliquent qu’ils désirent le respecter pour ses positions, mais qu’ils veulent exercer de manière constructive leur rôle politique d’opposition. Le conseiller, étonné de cette déclaration insolite, leur demande où ils ont appris à faire de la politique de cette manière. Les deux jeunes lui expliquent qu’ils font partie d’un petit groupe de l’école de formation du Mouvement Politique pour l’Unité (MPPU). Quelque temps après, même le conseiller communal commence à fréquenter l’école politique locale du MPPU.
Un conseiller communal, chef de file du parti de la majorité de la ville argentine de Mar del Plata (Argentine), voit entrer dans son bureau deux jeunes qui se présentent comme des activistes de l’opposition. Le conseiller, curieux, les reçoit. Avec simplicité les deux jeunes expliquent qu’ils désirent le respecter pour ses positions, mais qu’ils veulent exercer de manière constructive leur rôle politique d’opposition. Le conseiller, étonné de cette déclaration insolite, leur demande où ils ont appris à faire de la politique de cette manière. Les deux jeunes lui expliquent qu’ils font partie d’un petit groupe de l’école de formation du Mouvement Politique pour l’Unité (MPPU). Quelque temps après, même le conseiller communal commence à fréquenter l’école politique locale du MPPU.
Chiara Lubich n’aura sans doute pas connu ce tout petit épisode, perdu dans l’océan des milliers d’autres faits que nombre de membres du MPPU venant de tant de pays auraient pu évoquer.
Malgré cela, on peut sans aucun doute le considérer comme un effet typique de la rencontre avec la pensée et l’esprit du charisme de l’unité dont Chiara était porteuse et qui a comme paradigme l’idéal de fraternité universelle. Comment ? En préparant les citoyens et donc une société civile, sensible à la vie de la communauté politique dans laquelle ils sont insérés. Une citoyenneté active, en somme.
Un plongeon dans l’histoire. Au cours de l’été 1959, pendant deux mois, un total de 12000 personnes ont séjourné quelques jours ou plus à la mariapoli qui s’est tenue dans la vallée de Primiero (Dolomites). Elles venaient de 27 pays des cinq continents. Ces jours-là Chiara affirmait : “Le moment est arrivé… où chaque peuple doit dépasser ses propres frontières et regarder au-delà; il est arrivé le temps où l’on doit aimer la patrie de l’autre comme la sienne ». Paroles courageuses à une époque où les effets du terrible conflit mondial pouvaient encore se voir ; paroles inspiratrices de nouveaux rapports entre peuples et gouvernements. Aimer la patrie de l’autre comme la sienne est encore aujourd’hui une idée forte, une ligne directrice d’action, qui part des plus faibles et des plus pauvres.
Philadelphie (USA), 2003. Durant la “journée de l’interdépendance” qui s’est déroulée dans cette ville, Chiara écrit dans son message : “ De plusieurs points de la terre, aujourd’hui, monte le cri d’abandon de millions de réfugiés, de millions d’affamés, de millions d’opprimés, de millions de chômeurs qui sont exclus et comme « coupés » du corps politique. C’est cette séparation, et pas uniquement les privations et les difficultés économiques qui les rendent encore plus pauvres, qui augmente leur désespoir. La politique n’aura pas rejoint son but, elle n’aura pas gardé la foi en sa vocation tant qu’elle n’aura pas reconstitué cette unité et guéri ces plaies ouvertes dans le corps politique de l’humanité ». Mais pour arriver à ce but on aura besoin de la fraternité, parce que « liberté et égalité, face aux défis du présent et du futur de l’humanité, ne sont pas suffisantes à elles seules(…). Egalité et liberté seront toujours incomplètes et précaires, tant que la fraternité ne fera partie intégrante des programmes et des processus politiques dans toutes les régions du monde ».
Ce ne sont pas de simples paroles celles de Chiara, mais le fruit de l’expérience d’un mouvement qui au cours de son développement a étendu son regard sur le monde en s’appropriant “les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes d’aujourd’hui”.
Ce sera donc la société civile, qui se basera sur des citoyens animés par l’esprit de fraternité, comme l’a souhaité Chiara Lubich, qui précisera les limites et le contenu de la liberté et de l’égalité, les trois piliers de notre civilisation.
Texte intégral : Politics for Unity
Fév 27, 2015 | Non classifié(e), Parole di vie
Au cours d’un voyage en Galilée, près de Césarée de Philippe, Jésus demande à ses disciples ce qu’ils pensent de lui. Au nom de tous, Pierre affirme qu’il est le Christ, le Messie attendu depuis des siècles. Pour éviter des équivoques, Jésus explique clairement comment il entend réaliser sa mission. Il libérera son peuple, certainement, mais d’une manière inattendue, en payant de sa personne : il devra beaucoup souffrir, être condamné, mis à mort et, au bout de trois jours, ressusciter.
Pierre n’accepte pas cette vision du Messie ; comme beaucoup d’autres de son temps, il l’imaginait comme quelqu’un qui agirait avec force et puissance, chassant les Romains et mettant la nation d’Israël à sa juste place dans le monde. Il en fait donc le reproche à Jésus qui le réprimande à son tour : «…tes vues ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes » (Marc 8,31-33).
Jésus se remet en chemin, cette fois vers Jérusalem où s’accomplira son destin de mort et de résurrection. Maintenant que ses disciples savent qu’il va mourir, accepteront-ils encore de le suivre ? Les conditions que pose Jésus sont claires et exigeantes. Il appelle la foule et ses disciples autour de lui et leur dit :
« Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même et prenne sa croix, et qu’il me suive »
Sur les rives du lac alors qu’ils jetaient leurs filets pour la pêche, ou devant le bureau des impôts, lorsque Jésus les avait appelés à le suivre, ses disciples avaient alors été fascinés. Sans hésiter, ils avaient abandonné barques, filets, bureau, père, maison, famille pour courir à sa suite. Ils l’avaient vu accomplir des miracles et entendu ses paroles de sagesse. Jusqu’à aujourd’hui, ils l’avaient suivi remplis de joie et d’enthousiasme.
Cependant, suivre Jésus allait prendre maintenant un caractère nettement plus engageant, c’est-à-dire partager à fond sa vie et son destin : l’insuccès, l’hostilité et même la mort, et quelle mort ! La plus douloureuse et infamante, celle réservée aux assassins et aux délinquants les plus dangereux… Une mort que les Écritures qualifiaient de « maudite » (Deutéronome 21,23). Le seul nom de « croix » terrorisait, on n’osait même pas le prononcer. Cette parole apparaît pour la première fois dans l’Évangile. Qui sait quel choc elle a provoqué en ceux qui l’ont entendue !
Ayant affirmé clairement son identité, Jésus peut montrer avec la même clarté celle de son disciple. Si le Maître est celui qui aime son peuple jusqu’à mourir pour lui, en prenant sur lui la croix, le disciple, pour être tel, devra lui aussi mettre de côté sa propre façon de penser pour partager en tout, la voie du Maître, à commencer par celle de la croix :
« Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même et prenne sa croix, et qu’il me suive ».
Être chrétien signifie être d’autres Christ : avoir « les mêmes sentiments que le Christ Jésus », il « s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, à la mort sur une croix » (Philippiens 2,5-8) ; être crucifié avec le Christ au point de pouvoir dire avec Paul : «…je vis mais ce n’est plus moi, c’est Christ qui vit en moi » (Galates 2,20) ; ne rien savoir « sinon Jésus Christ et Jésus Christ crucifié » (1 Corinthiens 2,2). Jésus continue à vivre, à mourir, à ressusciter en nous. C’est le plus grand désir, la plus grande ambition du chrétien, celle qui a modelé les grands témoins : être comme le Maître. Mais comment suivre Jésus pour devenir comme lui ?
Le premier pas est de « se renier soi-même », se distancer de sa propre façon de penser. C’est ce que Jésus a demandé à Pierre quand il l’a réprimandé pour avoir pensé selon les hommes et pas selon Dieu. Nous aussi, comme Pierre, nous voulons parfois nous affirmer de manière égoïste ou au moins selon nos propres critères. Nous recherchons le succès facile et immédiat, exempt de toute difficulté, nous regardons avec envie celui qui fait carrière, nous rêvons d’avoir une famille unie et de construire autour de nous une société fraternelle et une communauté chrétienne, sans devoir payer le prix requis.
« Se renier soi-même » signifie entrer dans la façon de penser de Dieu, telle que Jésus nous l’a montrée dans sa propre façon d’agir. C’est la logique du grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit, la logique de trouver plus de joie à donner qu’à recevoir (Actes des Apôtres 20,35), à offrir sa vie par amour, en un mot, prendre sur soi sa propre croix :
« Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même et prenne sa croix, et qu’il me suive ».
La croix – celle de « tous les jours », comme le dit l’évangile de Luc (Luc 9,23) – peut prendre bien des visages : maladie, chômage, incapacité de gérer les problèmes familiaux ou professionnels, échec pour créer des rapports authentiques, sens d’impuissance face aux grands conflits mondiaux, indignation devant les scandales répétés de notre société… La croix, inutile de la chercher. Elle nous arrive d’elle-même, peut-être de manière totalement inattendue et sous une forme que nous n’aurions jamais imaginée.
L’invitation de Jésus est de « prendre » la croix, sans la subir avec résignation comme un mal inévitable, sans la laisser nous écraser, sans la supporter non plus de façon stoïque et détachée… L’accueillir au contraire comme une possibilité de partager la sienne, de vivre en disciples aussi en cette situation et en communion avec lui dans cette souffrance, car c’est lui, le premier, qui a partagé notre croix. Quand Jésus s’est chargé de sa croix, il a pris avec elle sur ses épaules chacune de nos croix. Dans chaque souffrance, quelle qu’elle soit, nous pouvons rencontrer Jésus qui l’a déjà faite sienne.
Igino Giordani voit là le rôle inversé de Simon de Cyrène qui porte la croix de Jésus : la croix, dit-il, « est moins lourde si Jésus se fait notre Cyrénéen ». Et, dit-il, elle est encore moins lourde si nous la portons ensemble : « Une croix portée par une seule personne est écrasante ; portée ensemble par plusieurs, avec Jésus au milieu d’elles, c’est-à-dire en prenant comme Cyrénéen Jésus lui-même, elle devient légère, le joug n’est plus ressenti comme tel. L’escalade faite en cordée par beaucoup, d’un commun accord, devient une fête, et elle nous fait monter ».
Prendre la croix donc pour la porter avec lui, sachant que nous ne sommes pas seuls à la porter parce qu’il la porte avec nous, c’est se relier à Jésus, lui appartenir, jusqu’à la pleine communion avec lui, jusqu’à devenir d’autres ‘lui’. C’est ainsi que l’on suit Jésus et que l’on devient de vrais disciples. La croix sera alors vraiment pour nous, comme pour Christ « puissance de Dieu (1 Corinthiens 1-18), voie de résurrection. Dans chaque faiblesse, nous trouverons la force, dans chaque obscurité la lumière, dans chaque mort la vie, parce que nous trouverons Jésus.
Fabio Ciardi

Fév 27, 2015 | Non classifié(e)
 Pour Chiara Lubich il existe une vraie vocation à la politique, “C’est un appel personnel qui émerge des circonstances et parle à travers la conscience”. Appel dont la réponse « est avant tout un acte de fraternité : on agit dans la sphère publique, qui concerne les autres, en voulant leur bien comme si c’était le nôtre ». Cette action crée les conditions qui « permettent une relation continuelle avec tous les autres secteurs de la vie » – l’économie, la santé, la communication, l’art, la justice, pour ne citer que ceux-ci -, de sorte qu’ainsi, la société puisse elle-même, avec toutes ses composantes, réaliser pleinement son dessein ».
Pour Chiara Lubich il existe une vraie vocation à la politique, “C’est un appel personnel qui émerge des circonstances et parle à travers la conscience”. Appel dont la réponse « est avant tout un acte de fraternité : on agit dans la sphère publique, qui concerne les autres, en voulant leur bien comme si c’était le nôtre ». Cette action crée les conditions qui « permettent une relation continuelle avec tous les autres secteurs de la vie » – l’économie, la santé, la communication, l’art, la justice, pour ne citer que ceux-ci -, de sorte qu’ainsi, la société puisse elle-même, avec toutes ses composantes, réaliser pleinement son dessein ».
L’événement mondial consiste en une pluralité de manifestations qui se réaliseront en divers points de la planète et durant lesquelles seront mises en évidence les idéalités du charisme de Chiara Lubich en rapport avec l’agir politique, éclairées par des récits de changement personnel et d’engagement dans la chose publique, qui vont de l’expérience de se mettre ensemble pour affronter les problèmes du quartier à l’engagement politique au niveau national et international. Ce sont toutes des occasions pour se refocaliser avec une conscience renouvelée sur le « rêve » qui a animé la vie et la pensée de Chiara Lubich : « la fraternité universelle ».
Rendez-vous à Rome (Italie) le 12 mars au Parlement : le matin, dans la Petite salle des Groupes du Parlement italien, 300 jeunes des focolari en provenance du monde entier, entreront en dialogue avec des hommes politiques, des chercheurs et des représentants des institutions internationales. L’après-midi, dans la même salle, se déroulera le congrès intitulé : « Chiara Lubich : l’unité et la politique ».
A Strasbourg (France) du 13 au 15 mars, au siège du Conseil de l’Europe, le séminaire «Fraternité en politique: s’investir autrement dans la cité», invite à ouvrir de nouvelles pistes d’action pour favoriser le « vivre ensemble ».
Le 13 mars, au Glendon College de la York University de Toronto (Canada), un débat sur le thème : «Politics for Unity. Making a World of Difference». A Curitiba (Brésil), le congrès «Política pela unidade, fazendo toda a diferença no mundo» veut montrer qu’en politique le paradigme de l’unité fait toute la différence. A Séoul (Corée du Sud) la rencontre : « En voyage vers la fraternité universelle » aura lieu dans le Parlement qui fut dans le passé le théâtre de durs affrontements. D’autres congrès se tiendront à Nairobi (Kenya), Dar es Salaam (Tanzanie), Madrid (Espagne), Budapest (Hongrie), Prague (République Tchèque) et aussi dans d’autres villes : sur le site www.politicsforunity.com, la carte des événements programmés et les informations correspondantes. Une sélection de textes de Chiara Lubich, faite par le Comité scientifique de l’événement, est aussi disponible. Pour suivre les conversations en ligne, voici le mot-clic (hashtag) : #politics4unity.
La réflexion autour du thème “Chiara Lubich: l’unité et la politique” sera l’occasion, dans toutes ces aires culturelles et géographiques, d’inviter à approfondir toujours davantage le patrimoine que Chiara, dont la cause béatification a été ouverte le 27 janvier dernier, laisse à l’Histoire.

Fév 25, 2015 | Non classifié(e)
 « Il est 7 heures du matin du 28 avril à la gare centrale. Un jour et un lieu que les étudiants du Campus n’oublieront jamais. Quelque chose d’imprévu est en train de se passer et…ils doivent faire leur choix : c’est l’heure ! ». Une scène à haut impact émotif et théâtral ouvre CAMPUS, le nouveau musical du Gen Rosso, en avant première les 14 et 15 mars prochains à Loppiano, dans l’Auditorium du Centre International.
« Il est 7 heures du matin du 28 avril à la gare centrale. Un jour et un lieu que les étudiants du Campus n’oublieront jamais. Quelque chose d’imprévu est en train de se passer et…ils doivent faire leur choix : c’est l’heure ! ». Une scène à haut impact émotif et théâtral ouvre CAMPUS, le nouveau musical du Gen Rosso, en avant première les 14 et 15 mars prochains à Loppiano, dans l’Auditorium du Centre International.
La première mondiale de la Tournée sera présentée à Naples les 28 et 29 mars au Théâtre ”Mediterraneo Mostra d’Oltremare”.
Partie d’une idée originale de Chiara Lubich, l’œuvre s’inspire de faits réellement passés et arrive sur la scène après 10 ans de recherches aussi bien au niveau du contenu qu’au niveau artistique.
Le campus, comme notre ville
Valerio Cipri raconte : « Il m ‘est tout de suite apparu que l’ambiance du campus représente bien la métaphore du quotidien de nos cohabitations urbaines globalisées. Les villes aujourd’hui sont les contenants de lourdes contradictions qui vont de la dégradation de la délinquance, de la drogue, de la corruption, à la présence de lieux de ‘récupération’ dans lesquels les citoyens se réapproprient des espaces de solidarité, d’humanité. Et le message de Campus est justement celui-là : une société unie ne se réalise pas en annulant les différences, mais bien en regardant en face les défis, et en se retroussant les manches pour construire des rapports authentiques .Ayant en toile de fond, une époque, l’actuelle, marquée par les drames des peurs et des terrorismes, s’entremêlent les histoires d’un groupe d’étudiants, chacun avec ses rêves et ses projets pour le futur et avec un présent marqué par une charge laborieuse de blessures, d’angoisses, et de questions ».
Un spectacle courageux, entre sonorités passionnantes et actualité critique.
Le musical se compose de 23 morceaux, passages chorégraphiques qui interagissent avec des séquences filmées, des actions théâtrales et de mouvement. « Le projet artistique est le résultat de la coopération d’une équipe de professionnels internationaux » – explique Beni Enderle. « Les sonorités sont fortes et riches de contaminations, d’entrelacements harmoniques passionnants, avec des lyriques qui vont de la légèreté des atmosphères latines, au pathos des rythmiques afro, en une synthèse sonore qui touche et captive ».
« Peu à peu on s’immerge dans l’histoire et dans l’atmosphère du spectacle – poursuit Josè Manuel Garcia – on sent le souffle global qui émerge d’un dispositif narratif qui va droit au cœur des défis de l’époque contemporaine, à l’intérieur d’une colonne sonore originale et rigoureusement live qui balaie des rythmes et des sonorités Rock, Pop, Reggae, Samba-axe, Électronique contemporaine, Hip-hop jusqu’au Dubstep…
L’impact scénique est d’avant-garde. Jean Paul Carradori explique : « J’ai beaucoup travaillé dans des productions à caractère international. Campus a représenté pour moi le premier défi inattendu pour son dispositif dramaturge et théâtral très fort. Il était nécessaire de créer un climat qui en valorise les contenus et en même temps qui conduise le spectateur à s’immerger dans l’histoire ».
Produit par le Gen Rosso International Performing Arts Group (16 artistes de 9 pays) en une nouvelle méthodologie du travail artistique, technique, directif et de management, le Musical est le fruit d’une convergence et synergie d’un team international.
Billets en pré-vente : CLIQUE ICI (tel. 0559051102 – mail genrosso.campus@loppiano.it)
On-line: l’événement est disponible sur internet aux adresses concerto 14/03 – concerto 15/03
Télécharge ici l’affiche
Fév 24, 2015 | Non classifié(e)
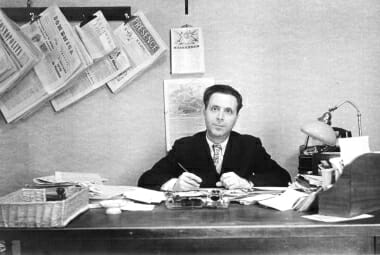
Fév 22, 2015 | Non classifié(e)
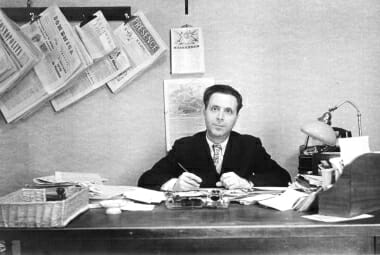 «Dans un monde rationnel, l’écrivain devrait se sentir au centre de la vie collective : comme celui qui dirige et interprète l’âme du peuple.
«Dans un monde rationnel, l’écrivain devrait se sentir au centre de la vie collective : comme celui qui dirige et interprète l’âme du peuple.
Mais le monde est pour une part dirigé par la rationalité : d’un autre côté, il est dirigé par l’instinct, par des passions irrationnelles : par exemple par la peur, et alors, l’écrivain devient populaire en fonction de ce qu’il recueille et peut-être en fonction des instincts des masses qu’il exaspère.
Aujourd’hui sont souverains la technique, la mécanique, le sport, le cinéma d’une part, la démagogie, l’affairisme, la politique d’abord de l’autre : et l’écrivain – s’il ne veut pas se réduire à la fonction marginale – doit se mettre au service d’intérêts matériels et passionnels ; écrire pour un journalisme souvent nécessairement asservi, par son énorme coût, à des groupes industriels, à des partis politiques, à des idéologies et à des professions qui ne visent que la rentabilité. La liberté de presse se perd parce que la presse se raréfie sous la pression financière ; et la liberté de l’écrivain se perd. Ceci aide à expliquer la disparition du type de grand écrivain ; et cela aide à expliquer pourquoi plus d’un, transfère son exercice dans l’arène politique ou cherche un soulagement dans d’autres domaines.
Par ailleurs, si c’est la décadence rationnelle des peuples qui produit la raréfaction, l’épuisement de l’écrivain et le réduit à la marginalité, c’est également vrai que c’est aussi la décadence spirituelle, morale et intellectuelle de celui qui écrit qui produit l’éloignement des lecteurs. La vérité est que l’écrivain est la cause et l’effet de son milieu social. Il faudrait qu’il y ait plus de cause que d’effet. Que s’il était ce qu’il doit être : un maître ou presque dirais-je, un apôtre ou un prophète, le peuple le suivrait et le lapiderait : il montrerait en somme un vif intérêt aux manifestations de son esprit. La place de l’écrivain est d’avant-garde : presque de reconnaissance : dans tous les cas de risque. En effet, pour accomplir une mission apostolique, de formation et d’élévation, l’écrivain risque pauvreté et incompréhension.
La position de l’écrivain est relative à la valeur du message qu’il porte ainsi qu’à la force et aux façons de l’expression artistique avec lesquelles il le porte.
Dans un monde où la technique et l’organisation, la planification et le centralisme, l’esprit grégaire et la fatigue de la liberté ont submergé l’âme de l’homme, en l’accablant de bruits et d’ordres, un écrivain libre qui concourrait à la libération spirituelle – à la rédemption de l’homme – en aidant à surmonter le ”déséquilibre”entre monde extérieur immense et monde intérieur exigu, il accomplirait une tâche plus grande que celle des hommes d’État les plus en vogue.
Dans un monde lézardé par les scissions et tremblant de la peur produite par la haine, une parole de fraternité et d’humanité, c’est – à- dire de charité, dite avec clarté, beauté et puissance, consacrerait son auteur à la gratitude des peuples, en lui conférant une situation de centre dans l’orbite de la civilisation ».
(De : Igino Giordani, Il compito dello scrittore, « La Via », 2.2.1952, p.3)

 Un conseiller communal, chef de file du parti de la majorité de la ville argentine de Mar del Plata (Argentine), voit entrer dans son bureau deux jeunes qui se présentent comme des activistes de l’opposition. Le conseiller, curieux, les reçoit. Avec simplicité les deux jeunes expliquent qu’ils désirent le respecter pour ses positions, mais qu’ils veulent exercer de manière constructive leur rôle politique d’opposition. Le conseiller, étonné de cette déclaration insolite, leur demande où ils ont appris à faire de la politique de cette manière. Les deux jeunes lui expliquent qu’ils font partie d’un petit groupe de l’école de formation du Mouvement Politique pour l’Unité (MPPU). Quelque temps après, même le conseiller communal commence à fréquenter l’école politique locale du MPPU.
Un conseiller communal, chef de file du parti de la majorité de la ville argentine de Mar del Plata (Argentine), voit entrer dans son bureau deux jeunes qui se présentent comme des activistes de l’opposition. Le conseiller, curieux, les reçoit. Avec simplicité les deux jeunes expliquent qu’ils désirent le respecter pour ses positions, mais qu’ils veulent exercer de manière constructive leur rôle politique d’opposition. Le conseiller, étonné de cette déclaration insolite, leur demande où ils ont appris à faire de la politique de cette manière. Les deux jeunes lui expliquent qu’ils font partie d’un petit groupe de l’école de formation du Mouvement Politique pour l’Unité (MPPU). Quelque temps après, même le conseiller communal commence à fréquenter l’école politique locale du MPPU.