Inde – Le Shanti Ashram et les Focolari : une longue amitié
En dialogue avec Vinu Aram, Directrice du Centre international Shanti Ashram. By Marco Aleotti, Roberto Catalano, Giulio Mainenti. https://vimeo.com/430298481
En dialogue avec Vinu Aram, Directrice du Centre international Shanti Ashram. By Marco Aleotti, Roberto Catalano, Giulio Mainenti. https://vimeo.com/430298481
La vie du Gen Verde pendant la pandémie « Nous étions au beau milieu d’une tournée en Espagne et des nouvelles inquiétantes nous sont parvenues d’Italie concernant le Covid-19 et le nombre croissant de contaminations. Nous devions décider de suspendre ou non la tournée et de la manière de rentrer en Italie. Quelques heures (ou plutôt quelques minutes) pour décider de ce qu’il fallait faire, le communiquer aux organisateurs, et en un jour nous embarquer sur ce qui était la dernière embarcation quittant Barcelone ». Un souvenir bien marqué et toujours vivant que partage Mileni du Gen Verde quelques mois plus tard et alors qu’en Italie il semble que la pandémie de Covid-19 refasse des apparitions. Au cours de ces 4 mois, le Gen Verde a transformé une situation douloureuse en une grande opportunité : « nous nous sommes immédiatement demandé – raconte Annalisa – comment aider les gens ; certains amis, qui avaient contracté le virus, nous ont demandé de rester proches d’eux… mais comment ? Comment ne pas les laisser seuls dans ces moments terribles tout en respectant la distanciation sociale ? Nous avons immédiatement eu l’idée de nous connecter depuis chez nous ». Ainsi commence l’aventure du premier streaming en direct : peu d’outils, un réseau internet médiocre pour supporter une connexion que nous ne savions pas si elle arriverait aux gens ni combien de personnes auraient pu la voir. Des mois plus tard, nous pouvons dire que le Gen Verde a réalisé de nombreux streamings en direct, ainsi que des dizaines et des dizaines de rendez-vous via le zoom, l’instagram, le skype… des occasions de rencontrer des jeunes et des moins jeunes du monde entier : des Philippines à l’Argentine, des États-Unis à la Roumanie, de l’Italie à l’Australie. Et puis ces mois ont aussi été le berceau propice à la création de nouvelles compositions : du monologue Il silenzio au morceau musical Tears and light, sans oublier les vidéos réalisées pour partager, même si à distance, le triduum de Pâques… et tout a été immédiatement partagé à travers les réseaux sociaux, la chaîne YouTube et le web. Peut-être plus de travail qu’en tournée, et le Gen Verde n’a jamais dit non à quiconque voulait vivre un moment de partage avec elles. « Nous sommes ravies – dit Marita – parce que ces derniers mois, nous avons rencontré des centaines de milliers de personnes ; je ne peux pas dire que c’était la même chose qu’en présence des personnes : il n’ y a pas de contact physique, on ne peut regarder personne dans les yeux… mais j’avoue qu’en 4 mois seulement, nous n’aurions jamais pu rencontrer autant de gens. Pour nous du Gen Verde, ce fut une expérience au-delà de toute attente ». Et maintenant, avec l’annonce de la dernière réunion de ce premier cycle de rendez-vous, le Gen Verde se consacre à de nouveaux projets et de nouvelles propositions à partager dès que possible. Bref, le Gen Verde regarde toujours loin et ne s’arrête jamais. Mais quel en est le secret ? « Nous vivons sans regarder à nous-mêmes – explique Sally – ce qui nous intéresse, c’est de construire des relations qui visent à la fraternité universelle. En ces mois de pandémie, nous avons reçu beaucoup d’échos après nos streamings en direct et ce sont ces impressions qui nous ont toujours poussées à aller de l’avant en essayant de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous ne nous faisons pas d’illusions et ne voulons faire d’illusions à personne : la pandémie n’était pas une blague et dans de nombreux pays, la situation est encore très critique, mais nous sommes certaines que ce que nous avons fait a été pour beaucoup, vivre au moins un moment de soulagement qui a permis de reprendre des forces ».
Tiziana Nicastro
Chiara Lubich raconte le pacte spécial d’unité conclu avec Igino Giordani (qu’elle appelle “Foco”) le 16 juillet 1949, prélude à son expérience mystique de cet été-là. D’après une interview donnée à la journaliste Sandra Hoggett en 2002 https://vimeo.com/438648806

Les jeunes des Focolari ont lancé la nouvelle campagne #daretocare pour prendre soin de nos sociétés et de la planète Terre et être des citoyens actifs pour essayer de construire un morceau de monde uni. Ils ont interrogé Elena Pulcini, professeur de philosophie sociale à l’université de Florence en Italie.  Elena Pulcini, professeure de philosophie sociale à l’université de Florence, se consacre depuis de nombreuses années, en tant que chercheuse, au thème des soins. Elle s’est exprimée lors de la première diffusion en direct #daretocare des jeunes du mouvement des Focolari le 20 juin dernier. Quel impact a eu l’expérience de la pandémie, que nous traversons, sur votre vision des soins? « Il me semble qu’une image de soins en tant qu’assistance a émergé. Pensons à tout le personnel médical et sanitaire. Cela a réveillé des éléments positifs, des passions qui ont en quelque sorte été oubliées, telles que la gratitude, la compassion, la perception de notre vulnérabilité. Et cela est très positif car nous en avons vraiment besoin et c’est nécessaire de réveiller ce que j’appelle les passions empathiques. En même temps, cependant, le soin est resté un peu enfermé dans une signification essentiellement humanitaire, ce qu’on appelle en anglais “cure, le remède” et non “care, le soin”. Prendre soin doit devenir un mode de vie ». Nous aimons rêver d’une société dans laquelle prendre soin est l’épine dorsale des systèmes politiques locaux et mondiaux. Est-ce une utopie ou est-ce réalisable ? « Se soucier signifie certainement réagir à quelque chose. Dans ce cas, il s’agit de prendre conscience de l’existence de l’autre. À partir du moment où je m’en rends compte et que je ne suis pas fermé dans mon individualisme, nous stimulons une capacité qui réside en nous qui est l’empathie, c’est-à-dire que nous nous pouvons nous mettre dans la peau de l’autre. Mais qui est l’autre aujourd’hui ? Eh bien, nous voyons apparaître de nouveaux visages de ce que nous considérons comme l’autre. L’autre aujourd’hui est donc ce qui est différent, ce sont aussi les générations futures, c’est aussi la nature, l’environnement, la Terre qui nous accueille. La sollicitude devient donc vraiment la réponse globale aux grands défis de notre temps si nous savons la retrouver grâce à la capacité empathique de nous mettre en relation avec l’autre. Je ne sais donc pas si c’est vraiment faisable, mais je pense que nous ne pouvons pas perdre la perspective utopique. La responsabilité ne suffit pas, nous devons aussi cultiver l’espérance ». Quelles suggestions nous feriez-vous pour agir dans ce sens et orienter nos sociétés vers la prise en charge à partir des institutions ? « Je crois que nous devons agir en tous lieux où nous opérons pour sortir la prise en charge du milieu étroit de la sphère privée. (…) Je dois me considérer comme un sujet attentionné dans ma famille, dans ma profession d’enseignant, quand je rencontre un pauvre rejeté dans la rue ou quand je vais nager et m’étendre sur la plage, je dois m’occuper de toutes les dimensions. Nous devons adopter la prise en charge comme un mode de vie capable de briser notre individualisme illimité qui conduit non seulement à l’autodestruction de l’humanité, mais aussi à la destruction du monde vivant. Nous devons donc essayer de répondre par un traitement aux pathologies de notre société, ce qui signifie éduquer à la démocratie. J’aime beaucoup un philosophe du XIXe siècle, Alexis de Tocqueville, qui disait que « nous devons éduquer à la démocratie ». C’est une leçon que nous devons encore apprendre et je crois que cela signifie qu’il faut cultiver ses propres émotions empathiques afin d’être stimulé à prendre soin avec plaisir et satisfaction, et non par contrainte”.
Elena Pulcini, professeure de philosophie sociale à l’université de Florence, se consacre depuis de nombreuses années, en tant que chercheuse, au thème des soins. Elle s’est exprimée lors de la première diffusion en direct #daretocare des jeunes du mouvement des Focolari le 20 juin dernier. Quel impact a eu l’expérience de la pandémie, que nous traversons, sur votre vision des soins? « Il me semble qu’une image de soins en tant qu’assistance a émergé. Pensons à tout le personnel médical et sanitaire. Cela a réveillé des éléments positifs, des passions qui ont en quelque sorte été oubliées, telles que la gratitude, la compassion, la perception de notre vulnérabilité. Et cela est très positif car nous en avons vraiment besoin et c’est nécessaire de réveiller ce que j’appelle les passions empathiques. En même temps, cependant, le soin est resté un peu enfermé dans une signification essentiellement humanitaire, ce qu’on appelle en anglais “cure, le remède” et non “care, le soin”. Prendre soin doit devenir un mode de vie ». Nous aimons rêver d’une société dans laquelle prendre soin est l’épine dorsale des systèmes politiques locaux et mondiaux. Est-ce une utopie ou est-ce réalisable ? « Se soucier signifie certainement réagir à quelque chose. Dans ce cas, il s’agit de prendre conscience de l’existence de l’autre. À partir du moment où je m’en rends compte et que je ne suis pas fermé dans mon individualisme, nous stimulons une capacité qui réside en nous qui est l’empathie, c’est-à-dire que nous nous pouvons nous mettre dans la peau de l’autre. Mais qui est l’autre aujourd’hui ? Eh bien, nous voyons apparaître de nouveaux visages de ce que nous considérons comme l’autre. L’autre aujourd’hui est donc ce qui est différent, ce sont aussi les générations futures, c’est aussi la nature, l’environnement, la Terre qui nous accueille. La sollicitude devient donc vraiment la réponse globale aux grands défis de notre temps si nous savons la retrouver grâce à la capacité empathique de nous mettre en relation avec l’autre. Je ne sais donc pas si c’est vraiment faisable, mais je pense que nous ne pouvons pas perdre la perspective utopique. La responsabilité ne suffit pas, nous devons aussi cultiver l’espérance ». Quelles suggestions nous feriez-vous pour agir dans ce sens et orienter nos sociétés vers la prise en charge à partir des institutions ? « Je crois que nous devons agir en tous lieux où nous opérons pour sortir la prise en charge du milieu étroit de la sphère privée. (…) Je dois me considérer comme un sujet attentionné dans ma famille, dans ma profession d’enseignant, quand je rencontre un pauvre rejeté dans la rue ou quand je vais nager et m’étendre sur la plage, je dois m’occuper de toutes les dimensions. Nous devons adopter la prise en charge comme un mode de vie capable de briser notre individualisme illimité qui conduit non seulement à l’autodestruction de l’humanité, mais aussi à la destruction du monde vivant. Nous devons donc essayer de répondre par un traitement aux pathologies de notre société, ce qui signifie éduquer à la démocratie. J’aime beaucoup un philosophe du XIXe siècle, Alexis de Tocqueville, qui disait que « nous devons éduquer à la démocratie ». C’est une leçon que nous devons encore apprendre et je crois que cela signifie qu’il faut cultiver ses propres émotions empathiques afin d’être stimulé à prendre soin avec plaisir et satisfaction, et non par contrainte”.
Par les jeunes des Focolari
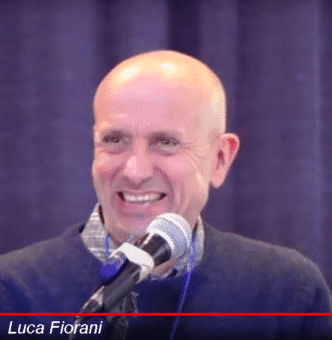
Cinq ans après la publication de l’Encyclique du Pape François, le paradigme de l’écologie intégrale guide la lecture de cette période de pandémie. Nous en parlons avec Luca Fiorani, responsable d’EcoOne. 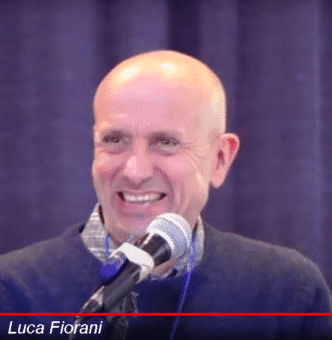 Cinq ans se sont écoulés depuis la publication de Laudato Si, l’encyclique du Pape François sur la préservation de la planète. Nous en parlons avec Luca Fiorani, professeur aux universités de Lumsa, Marconi et Sophia, chercheur à l’ENEA et responsable d’EcoOne, le réseau écologique du mouvement des Focolari. En ce temps de pandémie, quelles leçons pouvons-nous tirer de Laudato Si et de son paradigme d’écologie intégrale ? Je pense au « tout est connecté ». Le Pape, avant la pandémie, nous a fait savourer le côté positif, la merveilleuse relation qui existe entre les éléments naturels, y compris la personne. La pandémie, en revanche, a souligné le côté sombre de ce « tout est connecté », car l’activité humaine, qui a conduit à la destruction des habitats naturels, et le saut d’espèces du virus de l’animal à l’homme sont liés. Quel est le fondement évangélique de l’engagement à prendre soin de la création ? C’est « Aime ton prochain comme toi-même ». L’un des concepts clés de Laudato Si est « écouter à la fois le cri de la terre et le cri des pauvres ». Il est vrai que pour l’Évangile, la nature a une valeur en soi, mais il est également vrai que prendre soin de la nature signifie assurer une planète saine pour les plus défavorisés et pour nos enfants. Il s’agit de nous rappeler le « milliard inférieur », ce milliard de personnes qui sont victimes de « pandémie chronique » due aux 17 maladies tropicales négligées. Le concept d’écologie intégrale peut-il guider les voies d’avenir ? C’est le concept fondamental de tout l’enseignement du Pape François qui nous invite à dépasser le système socio-économique actuel. Nous vivons aujourd’hui dans le paradigme de la révolution industrielle, qui considère que les ressources naturelles sont illimitées. Ces ressources sont au contraire limitées et nous devons donc trouver un modèle de développement différent qui tienne également compte des besoins des peuples oubliés par les sociétés dites « évoluées ». Laudato Si appelle à une « conversion écologique ». Que signifie vivre les principes de l’écologie intégrale ? L’écologie intégrale concerne non seulement l’environnement mais aussi tous les aspects de la vie humaine, de la société, de l’économie et de la politique. Par conséquent, chacun d’entre nous doit essayer de changer sa vie en commençant, par exemple, par les choix de consommation. Nous pourrons alors choisir les gouvernants sensibles à la protection de la nature et faire campagne pour influencer en faveur d’un désinvestissement des combustibles fossiles au profit des énergies renouvelables. En cette année spéciale de célébrations de Laudato Si, avec quelles initiatives le mouvement des Focolari sera-t-il présent ? Le Mouvement participe aux initiatives de l’Église Catholique et aux événements promus par le Mouvement catholique mondial pour le climat, auquel il adhère. En outre, il organise la conférence “New ways towards integral ecology” qui se tiendra à Castel Gandolfo (RM) du 23 au 25 octobre, dont les détails sont disponibles sur www.ecoone.org. Ton dernier livre est intitulé « Il sogno (folle) di Francesco » (le rêve [fou]de François). Un petit manuel (scientifique) d’écologie intégrale ». Pourquoi parler d’un rêve fou ? Parce qu’il semble vraiment impossible de changer le cours de cette planète, vers un monde où nous nous sentons tous frères et sœurs et où nous construisons plus de ponts que de murs, mais – comme le disait la fondatrice du mouvement des Focolari, Chiara Lubich – « seuls ceux qui ont de grands idéaux font l’histoire » !
Cinq ans se sont écoulés depuis la publication de Laudato Si, l’encyclique du Pape François sur la préservation de la planète. Nous en parlons avec Luca Fiorani, professeur aux universités de Lumsa, Marconi et Sophia, chercheur à l’ENEA et responsable d’EcoOne, le réseau écologique du mouvement des Focolari. En ce temps de pandémie, quelles leçons pouvons-nous tirer de Laudato Si et de son paradigme d’écologie intégrale ? Je pense au « tout est connecté ». Le Pape, avant la pandémie, nous a fait savourer le côté positif, la merveilleuse relation qui existe entre les éléments naturels, y compris la personne. La pandémie, en revanche, a souligné le côté sombre de ce « tout est connecté », car l’activité humaine, qui a conduit à la destruction des habitats naturels, et le saut d’espèces du virus de l’animal à l’homme sont liés. Quel est le fondement évangélique de l’engagement à prendre soin de la création ? C’est « Aime ton prochain comme toi-même ». L’un des concepts clés de Laudato Si est « écouter à la fois le cri de la terre et le cri des pauvres ». Il est vrai que pour l’Évangile, la nature a une valeur en soi, mais il est également vrai que prendre soin de la nature signifie assurer une planète saine pour les plus défavorisés et pour nos enfants. Il s’agit de nous rappeler le « milliard inférieur », ce milliard de personnes qui sont victimes de « pandémie chronique » due aux 17 maladies tropicales négligées. Le concept d’écologie intégrale peut-il guider les voies d’avenir ? C’est le concept fondamental de tout l’enseignement du Pape François qui nous invite à dépasser le système socio-économique actuel. Nous vivons aujourd’hui dans le paradigme de la révolution industrielle, qui considère que les ressources naturelles sont illimitées. Ces ressources sont au contraire limitées et nous devons donc trouver un modèle de développement différent qui tienne également compte des besoins des peuples oubliés par les sociétés dites « évoluées ». Laudato Si appelle à une « conversion écologique ». Que signifie vivre les principes de l’écologie intégrale ? L’écologie intégrale concerne non seulement l’environnement mais aussi tous les aspects de la vie humaine, de la société, de l’économie et de la politique. Par conséquent, chacun d’entre nous doit essayer de changer sa vie en commençant, par exemple, par les choix de consommation. Nous pourrons alors choisir les gouvernants sensibles à la protection de la nature et faire campagne pour influencer en faveur d’un désinvestissement des combustibles fossiles au profit des énergies renouvelables. En cette année spéciale de célébrations de Laudato Si, avec quelles initiatives le mouvement des Focolari sera-t-il présent ? Le Mouvement participe aux initiatives de l’Église Catholique et aux événements promus par le Mouvement catholique mondial pour le climat, auquel il adhère. En outre, il organise la conférence “New ways towards integral ecology” qui se tiendra à Castel Gandolfo (RM) du 23 au 25 octobre, dont les détails sont disponibles sur www.ecoone.org. Ton dernier livre est intitulé « Il sogno (folle) di Francesco » (le rêve [fou]de François). Un petit manuel (scientifique) d’écologie intégrale ». Pourquoi parler d’un rêve fou ? Parce qu’il semble vraiment impossible de changer le cours de cette planète, vers un monde où nous nous sentons tous frères et sœurs et où nous construisons plus de ponts que de murs, mais – comme le disait la fondatrice du mouvement des Focolari, Chiara Lubich – « seuls ceux qui ont de grands idéaux font l’histoire » !
Claudia Di Lorenzi
Être confinés a souvent mis notre charité à l’épreuve. En effet, il n’est pas facile de vivre enfermé dans une maison et de se retrouver au coude à coude. Lorsqu’on est proche, physiquement, on se heurte aux limites les uns des autres et cela nous demande un “surplus d’amour”, qui est : « tout supporter ». Il est consolant de savoir que Chiara Lubich, elle-même, dans sa vie de communauté, a rencontré ce type de difficultés. […] L’autre jour j’ai pris en main un livre […] qui a pour titre : Il segreto di Madre Teresa (Le secret de Mère Teresa), de Calcutta. Je l’ai ouvert un peu au hasard, au chapitre intitulé : « Une mystique de la charité », que j’ai lu ainsi que d’autres. Je me suis plongée dans cette lecture qui m’a beaucoup intéressée. Tout ce qui concerne cette personne me touche personnellement : elle dont l’amitié m’a été, des années durant, très précieuse et qui sera prochainement béatifiée. L’aspect extrêmement radical de sa vie, de sa vocation me saute aux yeux. J’en suis impressionnée, j’en éprouve presque de la crainte, mais surtout cela me pousse à vouloir l’imiter selon l’engagement caractéristique, radical, que Dieu me demande. […] Animée de cette certitude, j’ai repris en main nos Statuts, certaine que c’est là que je pourrai trouver la mesure et le genre de vie radicale que le Seigneur me demande. Dès la première page, je reçois comme un choc spirituel, car voilà que je découvre à ce moment-là quelque chose que je connais pourtant depuis 60 ans ! Il s’agit de la « norme des normes », du « préambule à toute règle » de ma vie, de notre vie : d’abord et avant tout engendrer – l’expression est de Paul VI –, puis garder, Jésus au milieu de nous au moyen de l’amour mutuel. […] Aussitôt j’ai pris la résolution de vivre cette « norme des normes » dans mon focolare pour commencer, et avec mon entourage le plus proche. Nous le savons : « Que celui d’entre vous qui n’a jamais péché lui jette la première pierre »[1]. Chez nous tout n’est pas toujours parfait : certaines paroles sont inutiles, de ma part ou de la part des autres, certains silences sont inopportuns, il y a des jugements irréfléchis, des petits attachements, des souffrances mal vécues, qui empêchent que Jésus au milieu de nous soit à son aise, quand cela ne va pas jusqu’à en empêcher la présence. Alors je comprends que c’est moi qui, la première, dois lui donner toute sa place, en aplanissant la voie, en comblant les vides. Bref, en faisant en sorte que l’ingrédient de la charité ne manque jamais ; en supportant tout, en moi et chez les autres. Car l’apôtre Paul conseille vivement de « tout supporter », un mot qui n’est pas beaucoup en usage entre nous. Supporter ne relève pas de n’importe quelle charité, mais d’une charité spéciale, de la quintessence de la charité. Je m’y mets. Cela ne va pas mal, au contraire ça marche. En d’autres circonstances, j’aurais invité sans attendre mes compagnes à faire de même. Cette fois-ci, je préfère m’en abstenir. Je sens le devoir de faire d’abord toute ma part et cela fonctionne. J’ai le cœur plein de bonheur sans doute parce que, de cette façon, Jésus revient parmi nous et il y demeure. Plus tard j’en parlerai, mais en continuant à ressentir le devoir d’avancer ainsi comme si j’étais seule. Ma joie est à son comble lorsque les paroles de Jésus me reviennent à l’esprit : « C’est la miséricorde que je veux et non le sacrifice »[2]. « La miséricorde ! », c’est bien cela la charité raffinée qui nous est demandée et qui vaut plus que tous les sacrifices car le plus beau sacrifice que je puisse faire, c’est cet amour qui sait supporter, qui sait, le cas échéant, pardonner et oublier. […] C’est cela l’aspect radical qu’il nous est demandé de vivre.
Chiara Lubich
(Extrait d’une conférence téléphonique du 20 février 2003, à Rocca di Papa.) [1] Cf. (Jn 8, 7) [2] (Mt 9, 13)